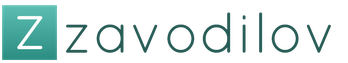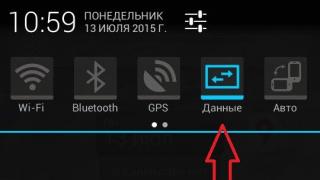Dodoétaient des oiseaux incapables de voler de la taille d'une oie. On suppose qu'un oiseau adulte pesait 20-25 kg (à titre de comparaison: la masse d'une dinde est de 12-16 kg), il atteignait un mètre de hauteur.
Les pattes du dodo à quatre doigts ressemblaient à celles d'une dinde, le bec est très massif. Contrairement aux pingouins et aux autruches, les dodos pouvaient non seulement voler, mais aussi bien nager ou courir vite : il n'y avait pas de prédateurs terrestres sur les îles et il n'y avait rien à craindre.
À la suite de siècles d'évolution, le dodo et ses frères ont progressivement perdu leurs ailes - il ne restait que quelques plumes sur eux et la queue s'est transformée en une petite crête.
Des dodos ont été trouvés dans les îles Mascareignes dans l'océan Indien. Ils vivaient dans des forêts, gardés par paires séparées. Ils nichaient sur le sol, pondant un gros œuf blanc.
Les dodos ont complètement disparu avec l'arrivée des Européens sur les îles Mascareignes - d'abord les Portugais, puis les Néerlandais.
La chasse au dodo est devenue une source de ravitaillement des navires, des rats, des cochons, des chats et des chiens ont été amenés sur les îles, qui ont mangé les œufs d'un oiseau sans défense.
Pour chasser un dodo, il suffisait de s'approcher de lui et de le frapper sur la tête avec un bâton. N'ayant auparavant aucun ennemi naturel, le dodo était confiant. C'est peut-être pour cette raison que les marins lui ont donné le nom de "dodo" - du mot portugais courant "doudo" ("doido" - "stupide", "fou").
Dodo(Raphinae) est une sous-famille éteinte d'oiseaux incapables de voler, anciennement connue sous le nom de didinae. Les oiseaux de cette sous-famille vivaient dans les îles Mascareignes, Maurice et Rodrigues, mais se sont éteints à la suite de la chasse par les humains et de la prédation par les rats et les chiens introduits par les humains.
Dodo appartiennent à l'ordre des Pigeons et ont deux genres, les genres Pezophaps et Raphus. Le premier contenait le dodo de Rodrigues (Pezophaps solitaria) et le second le dodo mauricien (Raphus cucullatus). Ces oiseaux ont atteint des tailles impressionnantes en raison de leur isolement sur les îles.
Le parent vivant le plus proche du dodo est le pigeon à crinière est le dodo et le dodo de Rodrigues.
Le pigeon à crinière est le parent le plus proche du dodo.
Le dodo mauricien (Raphus cucullatus), ou dodo, vivait sur l'île Maurice ; la dernière mention en fait référence à 1681, il y a un dessin de l'artiste R. Saverey en 1628.
L'une des images les plus célèbres et les plus souvent copiées du dodo, créée par Roulant Severey en 1626
Le dodo de Rodrigues (Pezophaps solitaria), ou dodo ermite, vivait sur l'île de Rodrigues, s'est éteint après 1761, a peut-être survécu jusqu'au début du XIXe siècle.
dodo mauricien, ou dodo(Raphus cucullatus) - une espèce éteinte, était endémique à l'île Maurice.
La première mention documentée du dodo est apparue grâce aux navigateurs hollandais arrivés sur l'île en 1598.
Avec l'avènement de l'homme, l'oiseau est devenu une victime des marins, et la dernière observation dans la nature, largement reconnue par la communauté scientifique, a été enregistrée en 1662.
La disparition n'a pas été immédiatement remarquée et pendant longtemps de nombreux naturalistes ont considéré le dodo comme une créature mythique, jusqu'à ce que dans les années 40 du 19ème siècle une étude soit faite sur les restes survivants d'individus amenés en Europe au début du 17ème siècle. Dans le même temps, la relation des dodos avec les pigeons a été indiquée pour la première fois.
Un grand nombre de restes d'oiseaux ont été collectés sur l'île Maurice, principalement dans la zone du marais Mar aux Saunges.
L'extinction de cette espèce en moins d'un siècle depuis sa découverte a attiré l'attention de la communauté scientifique sur le problème jusqu'alors inconnu de l'implication humaine dans l'extinction des animaux.
Dodo de Rodrigues, ou dodo ermite(Pezophaps solitaria) - éteint oiseau incapable de voler famille des pigeons, endémique de l'île Rodrigues, située à l'est de Madagascar dans l'océan Indien. Son parent le plus proche était le dodo de Maurice (les deux espèces formaient la sous-famille du dodo).
De la taille d'un cygne, le dodo de Rodrigues présentait un dimorphisme sexuel prononcé. Les mâles étaient beaucoup plus gros que les femelles et atteignaient jusqu'à 90 cm de long et 28 kg de poids. Les femelles atteignaient jusqu'à 70 cm de long et pesaient 17 kg. Le plumage des mâles était gris et brun, tandis que celui des femelles était pâle.
Le dodo de Rodrigues est le seul oiseau éteint dont les astronomes ont donné le nom à une constellation. Il s'appelait Turdus Solitarius, et plus tard - Lone Thrush.
L'apparition du dodo n'est connue que par des images et des sources écrites du XVIIe siècle. Étant donné que ces croquis uniques qui ont été copiés à partir de spécimens vivants et qui ont survécu à ce jour diffèrent les uns des autres, l'apparence exacte de l'oiseau au cours de sa vie reste inconnue avec certitude.
De même, peu de choses peuvent être dites avec certitude sur ses habitudes. Les restes montrent que le dodo mauricien mesurait environ 1 mètre de haut et pouvait peser 10 à 18 kg.
L'oiseau représenté dans les peintures avait un plumage gris brunâtre, des pattes jaunes, une petite touffe de plumes de la queue et une tête grise sans plumes avec un bec noir, jaune ou vert.
L'habitat principal du dodo était probablement les forêts des zones côtières plus sèches de l'île. On pense que le dodo mauricien a perdu sa capacité à voler en raison de la présence d'un grand nombre de sources de nourriture (qui auraient inclus des fruits tombés) et de l'absence de prédateurs dangereux sur l'île.
Les ornithologues de la première moitié du 19e siècle attribuaient le dodo aux petites autruches, aux bergers et aux albatros, et le considéraient même comme une sorte de vautour !
Ainsi en 1835, Henri Blainville, examinant un moulage du crâne obtenu au musée d'Oxford, conclut que l'oiseau était apparenté à... des cerfs-volants !
En 1842, le zoologiste danois Johannes Theodor Reinhart a suggéré que les dodos étaient des pigeons terrestres sur la base de recherches sur un crâne qu'il a découvert dans la collection royale de Copenhague. Initialement, cette opinion était considérée comme ridicule par les collègues du scientifique, mais en 1848, il fut soutenu par Hugh Strickland et Alexander Melville, qui publièrent la monographie "Dodo et ses parents" (TheDodoandItsKindred).
Après que Melville ait disséqué la tête et la patte d'un spécimen conservé au Musée d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford et les ait comparées aux restes du dodo de Rodrigues éteint, les scientifiques ont découvert que les deux espèces étaient étroitement liées. Strickland a établi que bien que ces oiseaux ne soient pas identiques, ils avaient de nombreux caractéristiques communes dans la structure des os des jambes, caractéristique uniquement pour les pigeons.
Le dodo mauricien ressemblait aux pigeons à bien des égards anatomiques. Cette espèce différait des autres membres de la famille principalement par des ailes sous-développées, ainsi que par un bec beaucoup plus gros par rapport au reste du crâne.
Au cours du 19ème siècle, plusieurs espèces ont été attribuées au même genre avec le dodo, y compris le dodo ermite de Rodrigues et le dodo de la Réunion sous le nom de Didus solitarius et Raphus solitarius, respectivement.
De gros os trouvés sur l'île Rodrigues (maintenant trouvés comme ceux d'un dodo ermite mâle) ont conduit ED Bartlett à l'existence d'une nouvelle espèce plus grande, qu'il a nommée Didus nazarenus (1851). Auparavant, il a été inventé par I. Gmelin (1788) pour le soi-disant. "Oiseau de Nazareth" - description en partie mythique du dodo, publiée en 1651 par François Coche. Il est maintenant reconnu comme synonyme de Pezophaps solitaria. Des croquis approximatifs d'un berger mauricien rouge ont également été attribués à tort à de nouvelles espèces de dodo : Didus broeckii (Schlegel, 1848) et Didus herberti (Schlegel, 1854).
Jusqu'en 1995, le soi-disant dodo blanc, ou réunionnais, ou bourbon (Raphus borbonicus) était considéré comme le parent éteint le plus proche du dodo. Ce n'est que relativement récemment qu'il a été établi que toutes ses descriptions et images avaient été mal interprétées, et les restes découverts appartiennent à un représentant éteint de la famille ibis. Il a finalement reçu le nom de Threskiornis solitarius.
Initialement, le dodo et le dodo ermite de l'île Rodrigues ont été attribués à différentes familles (Raphidae et Pezophapidae, respectivement), car on croyait qu'ils apparaissaient indépendamment les uns des autres. Puis, au fil des ans, ils se sont unis dans la famille des dodo (anciennement Dididae), puisque leur relation exacte avec les autres pigeons restait en question.
Cependant, une analyse ADN réalisée en 2002 a confirmé la relation des deux oiseaux et leur appartenance à la famille des pigeons. La même étude génétique a révélé que le parent moderne le plus proche des dodos est le pigeon à crinière.
Les restes d'un autre grand, légèrement plus petit que le dodo et le dodo de Rodrigues, le pigeon incapable de voler Natunaornis gigoura ont été trouvés sur l'île de Viti Levu (Fidji) et décrits en 2001. On pense qu'il est également lié aux pigeons couronnés.
Une étude génétique en 2002 a montré que la séparation des « pedigrees » des dodos rodriguais et mauriciens s'est produite dans la région de la frontière du Paléogène et du Néogène il y a environ 23 millions d'années.
Les îles Mascareignes (Maurice, Réunion et Rodrigues) sont d'origine volcanique avec un âge ne dépassant pas 10 millions d'années. Ainsi, les ancêtres communs de ces oiseaux doivent avoir conservé longtemps la capacité de voler après la séparation.
L'absence de mammifères herbivores à Maurice, qui pouvaient rivaliser avec la nourriture, a permis aux dodos d'atteindre de très grandes tailles. Dans le même temps, les oiseaux n'étaient pas menacés par les prédateurs, ce qui entraînait la perte de la capacité de voler.
Apparemment, le premier nom documenté du dodo est le mot néerlandais walghvogel, qui est mentionné dans le journal du vice-amiral Wiebrand van Warwijk, qui s'est rendu à Maurice lors de la deuxième expédition néerlandaise en Indonésie en 1598.
Le mot anglais wallowbirdes , qui peut littéralement être traduit par «oiseaux insipides», est un papier calque de l'homologue néerlandais walghvogel ; le mot vautrer est dialectal et apparenté au moyen néerlandais walghe signifiant «insipide», «insipide» et «nauséeux».
Un autre rapport de la même expédition, écrit par Heindrik Dirks Yolinka (c'est peut-être la toute première mention du dodo), dit que les Portugais qui avaient déjà visité Maurice appelaient ces oiseaux "pingouins". Cependant, ils utilisaient le mot fotilicaios pour désigner les seuls manchots à lunettes alors connus, et ce que le Néerlandais mentionnait semble être dérivé du pignon portugais (« aile coupée »), indiquant évidemment la petite taille de ceux des dodos.
L'équipage du navire hollandais "Gelderland" en 1602 les appelait le mot dronte (signifiant "gonflé", "gonflé"). De là est venu le nom moderne utilisé dans les langues scandinaves et slaves (dont le russe). Cet équipage les appelait aussi griff-eendt et kermisgans, en référence aux volailles engraissées pour la fête patronale de Kermesse à Amsterdam, qui se tenait le lendemain du mouillage des marins au large de l'île Maurice.
L'origine du mot "dodo" n'est pas claire. Certains chercheurs l'élèvent au néerlandais "dodoor" ("paresseux"), d'autres au "dod-aars" signifiant "gros cul" ou "noueux", avec lequel les marins ont probablement voulu souligner une caractéristique telle qu'une touffe de plumes dans la queue d'un oiseau (Strickland mentionne également sa signification d'argot avec l'analogue russe "salaga").
La première entrée du mot "dod-aars" se trouve en 1602 dans le journal de bord du capitaine Willem van West-Sahnen.
Le voyageur anglais Thomas Herbert a utilisé pour la première fois le mot "dodo" dans son essai de voyage de 1634, où il a affirmé qu'il était utilisé par les Portugais qui ont visité Maurice en 1507.
Emmanuel Altham a utilisé le mot dans une lettre de 1628, dans laquelle il a également déclaré son origine portugaise. Pour autant que l'on sache, aucune source portugaise survivante n'a mentionné cet oiseau. Cependant, certains auteurs prétendent encore que le mot "dodo" vient du portugais "doudo" (actuellement "doido"), qui signifie "imbécile" ou "fou". Il a également été suggéré que "dodo" était une onomatopée de la voix d'un oiseau, imitant le son à deux notes émis par les colombes et similaire à "doo-doo".
L'adjectif latin "cucullatus" a été appliqué pour la première fois au dodo mauricien en 1635 par Juan Eusebio Niremberg, qui a donné à l'oiseau le nom "Cygnus cucullatus" ("Cowled Swan"), basé sur l'image d'un dodo faite par Charles Clusius en 1605 .
Cent ans plus tard, dans un ouvrage classique du XVIIIe siècle intitulé Le système de la nature, Carl Linnaeus a utilisé le mot "cucullatus" comme nom d'espèce pour le dodo, mais en combinaison avec "Struthio" ("autruche").
En 1760, Mathurin-Jacques Brisson a introduit le nom de genre actuellement utilisé "Raphus" en y ajoutant l'adjectif ci-dessus.
En 1766, Carl Linnaeus a introduit un autre nom scientifique - "Didus ineptus" ("dodo stupide"), qui est devenu synonyme du nom antérieur selon le principe de priorité dans la nomenclature zoologique.
Peinture de Mansur de 1628 : "Dodo parmi les oiseaux indiens"
Puisqu'il n'y a pas d'instances complètes du dodo, il est difficile de déterminer ces caractéristiques. apparence, comme la nature et la couleur du plumage. Ainsi, les dessins et les preuves écrites des rencontres avec les dodos mauriciens dans la période entre la première preuve documentaire et la disparition (1598-1662) sont devenus les sources les plus importantes pour décrire leur apparition.
Selon la plupart des images, le dodo avait un plumage gris ou brunâtre avec des plumes de vol plus claires et une touffe de plumes claires bouclées dans la région lombaire.
La tête était grise et chauve, le bec était vert, noir ou jaune et les pattes étaient jaunâtres avec des griffes noires.
Les restes d'oiseaux apportés en Europe au 17ème siècle montrent qu'ils étaient très gros, environ 1 mètre de haut, et pouvaient peser jusqu'à 23 kg.
L'augmentation du poids corporel est caractéristique des oiseaux gardés en captivité; la masse des individus à l'état sauvage a été estimée entre 10 et 21 kg.
Une estimation ultérieure donne un poids moyen minimum d'un oiseau adulte de 10 kg, mais ce nombre a été remis en question par un certain nombre de chercheurs. On suppose que le poids corporel dépendait de la saison : dans la période chaude et humide de l'année, les individus devenaient obèses, dans la période sèche et chaude, c'était le contraire.
Cet oiseau était caractérisé par un dimorphisme sexuel : les mâles étaient plus grands que les femelles et avaient proportionnellement des becs plus longs. Ce dernier atteignait 23 cm de long et avait un crochet à son extrémité.
La plupart des descriptions contemporaines de dodos ont été trouvées dans les journaux de bord des navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui ont accosté au large de Maurice pendant la période coloniale de l'Empire néerlandais. Peu de ces rapports peuvent être considérés comme fiables, car certains d'entre eux étaient probablement basés sur des rapports antérieurs, et aucun d'entre eux n'a été rédigé par un naturaliste.
"... Les perroquets bleus étaient très nombreux ici, de même que d'autres oiseaux, parmi lesquels il y avait une espèce très visible en raison de sa grande taille - plus grande que nos cygnes, avec une tête énorme, à moitié recouverte de peau, et comme s'il est vêtu d'une cagoule. Ces oiseaux n'avaient pas d'ailes et à leur place sortaient 3 ou 4 plumes sombres. La queue se composait de plusieurs plumes douces et concaves de couleur cendrée. Nous les appelions Walghvögel car plus ils étaient cuits longtemps et souvent, moins ils devenaient mous et de plus en plus insipides. Néanmoins, leur ventre et leur poitrine avaient bon goût et étaient facilement mâchés ... "
L'une des descriptions les plus détaillées de l'oiseau a été faite par le voyageur anglais Thomas Herbert dans son livre A Relation of some yeares' Travaile, beginne Anno 1626, into Africa and the Greater Asia. , 1634):
Dessin réalisé par Thomas Herbert en 1634
Le voyageur français François Coche (François Cauche), dans un rapport publié en 1651 sur son voyage, qui comprenait un séjour de deux semaines à Maurice (à partir du 15 juillet 638), a laissé la seule description de l'œuf et de la voix d'un oiseau qui nous est parvenu.
“….. Ce n'est qu'ici et sur l'île de Digarrois (Rodrigues, signifiant probablement l'ermite dodo) que naît un oiseau dodo, qui par sa forme et sa rareté peut rivaliser avec le phénix arabe : son corps est rond et lourd, et il pèse moins plus de cinquante livres. Il est considéré comme plus de curiosité que de nourriture; d'eux même les estomacs gras peuvent tomber malades, et pour le tendre c'est une insulte, mais pas de la nourriture.
Dès son apparition, on peut voir le découragement causé par l'injustice de la nature, qui a créé un corps si énorme, complété par des ailes si petites et impuissantes qu'elles ne servent qu'à prouver qu'il s'agit d'un oiseau.
La moitié de sa tête est nue et comme recouverte d'un voile fin, le bec est courbé et au milieu de celui-ci se trouvent les narines, d'elles jusqu'à la pointe, il est vert clair mélangé à une teinte jaune pâle; ses yeux sont petits et ronds et roulent comme des diamants (?); sa tenue est constituée de plumes de duvet, sur la queue il y a trois plumes, courtes et disproportionnées. Ses jambes correspondent à son corps, ses griffes sont acérées. Il a un fort appétit et est gourmand. Capable de digérer les pierres et le fer, dont la description est mieux perçue à partir de son image...".
«... j'ai vu des oiseaux à Maurice plus gros qu'un cygne, sans plumes sur le corps, qui est recouvert de duvet noir; le dos est arrondi, la croupe est ornée de plumes bouclées dont le nombre augmente avec l'âge. Au lieu d'ailes, ils ont les mêmes plumes que les précédents : noirs et recourbés. Ils n'ont pas de langue, le bec est large et légèrement courbé ; les pattes sont longues, écailleuses, avec seulement trois orteils à chaque patte. Il a un cri comme un oison, mais cela ne signifie pas du tout un goût agréable, comme les flamants roses et les canards dont nous venons de parler. Dans la couvée ils ont un œuf, blanc, de la taille d'un petit pain de 1 sous, une pierre de la taille d'un œuf de poule y est appliquée. Ils se couchent sur l'herbe qu'ils ramassent et construisent leurs nids dans la forêt ; si vous tuez le poussin, vous pouvez trouver une pierre grise dans son ventre. Nous les appelons "les oiseaux de Nazareth". Leur graisse est un merveilleux remède pour soulager les muscles et les nerfs..."
De manière générale, le message de François Coche soulève quelques doutes, puisque, en plus de tout, il dit que "l'oiseau de Nazareth" a trois doigts et pas de langue, ce qui ne correspond pas du tout à l'anatomie des dodos mauriciens. Cela a conduit à la conclusion erronée que le voyageur a décrit une autre espèce apparentée, qui a ensuite reçu le nom de "Didus nazarenus". Cependant, très probablement, il a confondu ses informations avec des données sur les casoars alors peu étudiés, en outre, il y a d'autres déclarations contradictoires dans ses notes.
Quant à l'origine du concept d'"oiseau de Nazareth", le scientifique russe Joseph Hamel l'expliqua en 1848 en disant que ce Français, ayant entendu la traduction du nom original de l'oiseau "walghvogel" ("Oiseaudenausée" - "oiseau nauséabond "), le mot "nausée" (nausée) en corrélation avec le point géographique "Nazaret", indiqué sur les cartes de ces années près de Maurice.
La mention d'une "jeune autruche" embarquée à bord d'un navire en 1617 est le seul signalement d'un possible jeune dodo.
Un dessin d'une tête de dodo par Cornelis Saftleven en 1638 est la dernière représentation originale de l'oiseau.
Une vingtaine d'images de dodos du XVIIe siècle sont connues, copiées sur des représentants vivants ou empaillées.
Les dessins de différents artistes présentent des différences notables dans les détails, tels que la coloration du bec, la forme des plumes de la queue et la coloration générale. Certains experts, tels qu'Anton Cornelius Audemans et Masauji Hachisuka, ont proposé un certain nombre de versions selon lesquelles les peintures pourraient représenter des individus de sexe, d'âge ou à différentes périodes de l'année.
Enfin, il y a eu des suggestions sur différentes espèces, mais aucune de ces théories n'a été confirmée. À ce jour, sur la base des dessins, il est impossible de dire avec certitude dans quelle mesure ils reflétaient généralement la réalité.
Le paléontologue britannique et spécialiste du dodo Julian Hume soutient que les narines des dodos vivants devaient être en forme de fente, comme le montrent les croquis de la Gueldre, ainsi que dans les peintures de Cornelis Suftleven, Mansour et le travail d'un artiste inconnu du collection du musée d'art Crocker. Selon Hume, les narines grandes ouvertes souvent vues dans les peintures indiquent que les sujets étaient empaillés plutôt que des oiseaux vivants.
Un journal de bord du navire hollandais Gelderland (1601-1603), découvert dans les archives dans les années 1860, contient les seuls croquis authentiquement créés à Maurice à partir d'individus vivants ou récemment tués. Ils ont été dessinés par deux artistes, dont l'un, plus professionnel, pourrait s'appeler Joris Joostensz Laerle. Sur la base de quel matériel, oiseaux vivants ou animaux empaillés, des images ultérieures ont été créées, il n'est pas possible de le savoir aujourd'hui, ce qui nuit à leur fiabilité.
L'image classique du dodo est celle d'un oiseau très gras et maladroit, mais cette vue est probablement exagérée. L'opinion généralement acceptée des scientifiques est que bon nombre des anciennes images européennes ont été obtenues à partir d'oiseaux suralimentés en captivité ou grossièrement farcis.
Le peintre hollandais Roelant Savery était le peintre le plus prolifique et le plus influent des dodos. Il a peint au moins dix tableaux.
Son célèbre ouvrage de 1626, maintenant connu sous le nom de Dodo d'Edwards (maintenant dans la collection du Natural History Museum de Londres). Il est devenu une image typique du dodo et a servi de source principale à de nombreuses autres, malgré le fait qu'il montre un oiseau trop gras.
Presque rien n'est connu sur les habitudes du dodo en raison de la rareté des informations. Des études des os des membres postérieurs montrent que l'oiseau pouvait courir assez vite. Étant donné que le dodo mauricien était un oiseau incapable de voler et qu'il n'y avait pas de mammifères prédateurs ou d'autres ennemis sur l'île, il nichait probablement au sol.
Les préférences d'habitat du dodo sont inconnues, mais d'anciens rapports indiquent que ces oiseaux habitaient des forêts dans les zones côtières plus sèches du sud et de l'ouest de l'île Maurice. Cette opinion est étayée par le fait que le marais Mar-aux-Songs, dans lequel se trouvent la plupart des restes de dodos, est situé près de la mer, dans la partie sud-est de l'île. Une aire de répartition aussi limitée aurait pu contribuer de manière significative à l'extinction de l'espèce.
Sur une carte de 1601 du journal de bord du navire Gelderland, au large de l'île Maurice, une petite île est visible où des dodos ont été capturés. Julian Hume a suggéré que cette île se trouvait dans la baie de Tamarin, sur la côte ouest de l'île Maurice. Les restes d'oiseaux trouvés dans les grottes des zones montagneuses prouvent que des oiseaux ont également été trouvés sur les collines.
Croquis de trois dodos du Crocker Museum of Art, réalisé par Savery en 1626
« ….Ces bourgmestres sont majestueux et fiers. Ils se tenaient devant nous, résolus et déterminés, le bec grand ouvert. Vifs et audacieux en marchant, ils pouvaient à peine faire un pas à notre rencontre. Leur arme était un bec, avec lequel ils pouvaient mordre cruellement ; ils mangeaient des fruits; ils n'avaient pas un bon plumage, mais ils avaient assez de graisse en excès. Beaucoup d'entre eux, pour notre joie commune, ont été embarqués...".
En plus des fruits tombés, le dodo se nourrissait probablement de noix, de graines, de bulbes et de racines. Le zoologiste néerlandais Anton Cornelius Oudemans a suggéré que puisque Maurice a des saisons sèches et pluvieuses, le dodo s'est apparemment engraissé à la fin de la saison des pluies en mangeant des fruits mûrs afin de survivre à la saison sèche lorsque la nourriture était rare. Les contemporains ont décrit l'appétit "gourmand" de l'oiseau.
Certains pionniers considéraient la viande de dodo comme insipide et préféraient manger des perroquets ou des pigeons, d'autres la décrivaient comme dure mais bonne. Certains dodos chassaient uniquement pour les estomacs, qui étaient considérés comme la partie la plus savoureuse de l'oiseau. Les dodos étaient très faciles à attraper, mais les chasseurs devaient se méfier de leur bec puissant.
Ils se sont intéressés aux dodos et ont commencé à exporter des individus vivants vers l'Europe et l'Orient.
Le nombre d'oiseaux qui ont atteint leur destination en une seule pièce est inconnu et peu clair, car ils sont en corrélation avec des peintures de ces années et un certain nombre d'expositions dans des musées européens.
La description d'un dodo que Hamon Lestrange a vu à Londres en 1638 est la seule mention faisant directement référence à un spécimen vivant en Europe.
En 1626, Adrian van de Venne a dessiné un dodo qu'il prétendait avoir vu à Amsterdam, mais n'a pas dit s'il était vivant. Deux spécimens vivants ont été vus par Peter Mundy à Surate entre 1628 et 1634.
Dessin d'un spécimen qui se trouvait dans la collection de Prague de l'empereur Rodolphe II. L'auteur du dessin est Jacob Hufnagel
Dessin d'un dodo par Adrian van de Venne en 1626
La présence de dodos empaillés solides indique que les oiseaux ont été amenés vivants en Europe et y sont morts plus tard; il est peu probable qu'il y ait eu des taxidermistes à bord des navires qui sont venus à Maurice, et l'alcool n'a pas encore été utilisé pour conserver les expositions biologiques.
La plupart des expositions tropicales ont été conservées sous la forme de têtes et de pattes séchées. Sur la base d'une combinaison d'histoires contemporaines, de peintures et d'animaux empaillés, Julian Hume a conclu qu'au moins onze des dodos exportés avaient été livrés vivants à leurs destinations finales.
Comme beaucoup d'autres animaux qui se sont développés isolés de prédateurs sérieux, les dodos n'avaient pas du tout peur des humains. Ce manque de peur et son incapacité à voler faisaient de l'oiseau une proie facile pour les marins. Bien que des rapports anecdotiques aient décrit le massacre massif de dodos pour reconstituer les approvisionnements des navires, les études archéologiques n'ont pas trouvé de preuves solides de prédation humaine.
Les ossements d'au moins deux dodos ont été retrouvés dans des grottes près de BaieduCap, qui servaient de refuge aux marrons et aux condamnés en fuite au XVIIe siècle, et n'étaient pas facilement accessibles aux dodos en raison du terrain montagneux et accidenté.
Le nombre d'habitants à Maurice (un territoire de 1860 km²) au 17ème siècle n'a jamais dépassé 50 personnes, mais ils ont introduit d'autres animaux, notamment des chiens, des cochons, des chats, des rats et des singes crabiers, qui ont ravagé les nids de dodo et se sont disputés des places limitées. ressources alimentaires.
Dans le même temps, les gens ont détruit l'habitat forestier du dodo. L'impact sur l'abondance de l'espèce des porcs et des macaques introduits est actuellement considéré comme plus important et significatif que celui de la chasse. Les rats n'ont peut-être pas été une si grande menace pour les nids, car les dodos sont habitués à s'occuper des crabes terrestres indigènes.
On suppose qu'au moment où les gens sont arrivés à Maurice, le dodo était déjà rare ou avait une portée limitée, car il ne se serait pas éteint aussi rapidement s'il occupait toutes les zones reculées de l'île.
Il existe une controverse autour de la date de l'extinction du dodo. Le dernier rapport largement accepté d'observations de dodo est un rapport du marin Volkert Everts sur le navire néerlandais naufragé Arnhem daté de 1662. Il a décrit des oiseaux capturés sur une petite île près de Maurice (maintenant considérée comme l'île d'Îled'Ambre):
"... Ces animaux, quand nous nous sommes approchés, se sont figés, nous regardant, et sont restés tranquillement en place, comme s'ils ne savaient pas s'ils avaient des ailes pour s'envoler, ou des jambes pour s'enfuir, et nous permettant de les approcher comme fermer comme nous le voulions. Parmi ces oiseaux se trouvaient ceux qu'on appelle dans l'Inde Dod-aersen (c'est une espèce de très grosses oies) ; ces oiseaux ne savent pas voler, au lieu d'ailes, ils ont juste de petits processus, mais ils peuvent courir très vite. Nous les avons tous conduits au même endroit pour pouvoir les attraper avec nos mains, et lorsque nous avons attrapé l'une d'entre elles par la jambe, elle a fait un tel bruit que tous les autres ont immédiatement couru à son secours et, par conséquent, eux-mêmes ont également été capturés ... "
La dernière observation signalée du dodo a été enregistrée dans les registres de chasse du gouverneur de Maurice, Isaac Johannes Lamotius, en 1688, donnant une nouvelle date approximative pour la disparition du dodo - 1693.
Bien que la rareté du dodo ait été signalée dès le 17e siècle, son extinction n'a été reconnue qu'au 19e siècle. En partie pour des raisons religieuses, puisque l'extinction était considérée comme impossible (jusqu'à ce que Georges Cuvier prouve le contraire), et en partie parce que de nombreux scientifiques doutaient que les dodos aient jamais existé. En général, il semblait une créature trop étrange, tant de gens croyaient qu'il était un mythe. De plus, la possibilité a été prise en compte que les dodos auraient pu survivre sur d'autres îles encore inexplorées de l'océan Indien, malgré le fait que de vastes territoires de Madagascar et d'Afrique continentale restaient peu étudiés. Pour la première fois cet oiseau comme exemple d'extinction due à l'activité humaine a été cité en 1833 par le magazine britannique The Penny Magazine.
Les seuls restes survivants de dodos parmi les individus amenés en Europe au 17ème siècle sont :
- tête et patte séchées au musée d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford;
- une patte conservée au British Museum, aujourd'hui perdue ;
- un crâne au musée zoologique de Copenhague ;
- os de la mâchoire supérieure et de la jambe au Musée national de Prague.
Squelette compilé par Richard Owen à partir d'ossements trouvés dans le marais de Mar-aux-Songes
26 musées à travers le monde possèdent d'importantes collections de matériel biologique de dodo, dont la quasi-totalité se trouve à Mar-aux-Songes. Le musée d'histoire naturelle de Londres, le musée américain d'histoire naturelle, le musée de zoologie de l'université de Cambridge, le musée Senckenberg, le musée Darwin de Moscou et un certain nombre d'autres ont des squelettes presque complets constitués d'os individuels.
Le squelette du musée Darwin faisait auparavant partie de la collection d'un éleveur de chevaux russe, vice-président du bureau du département d'ornithologie de la société impériale russe pour l'acclimatation des animaux et des plantes et membre à part entière du comité ornithologique russe A. S. Khomyakov, nationalisé en 1920.
Imaginaire "dodo blanc" de l'île de la Réunion (ou de l'ermite dodo de la Réunion) est maintenant considérée comme une supposition erronée, basée sur des rapports contemporains de l'ibis de la Réunion et sur les représentations du XVIIe siècle d'oiseaux blancs ressemblant à des dodo faites au XVIIe siècle par Peter Witos et Peter Holstein.
La confusion a commencé lorsque le capitaine hollandais Bontecou, qui a visité la Réunion vers 1619, a mentionné dans son journal un oiseau lourd et incapable de voler appelé dod-eersen, bien qu'il n'ait rien écrit sur sa coloration.
Lorsque ce journal a été publié en 1646, il était accompagné d'une copie du croquis de Savery de la Crocker Art Gallery. L'oiseau blanc, dense et incapable de voler a été mentionné pour la première fois dans la faune réunionnaise par l'officier supérieur Tatton en 1625. Des mentions uniques ont ensuite été faites par le voyageur français Dubois et d'autres auteurs contemporains.
En 1848, le baron Michel-Edmond de Sély-Longchamp donna à ces oiseaux le nom latin de Raphus solitarius, car il pensait que ces signalements faisaient référence à une nouvelle espèce de dodo. Lorsque les naturalistes du 19ème siècle ont découvert des images de dodos blancs liés à XVIIe siècle, il a été conclu que c'était cette vue qui était capturée sur eux. Anton Cornelius Audemans a suggéré que la raison de l'écart entre les dessins et les anciennes descriptions réside dans le dimorphisme sexuel (les peintures auraient représenté des femmes). Certains auteurs pensaient que les oiseaux décrits appartenaient à une espèce similaire au dodo ermite de Rodrigues. Il est venu à l'hypothèse que des spécimens blancs de dodo et de dodo ermite vivaient à la Réunion.
Dodo blanc. Dessin de Peter Holstein. Milieu du XVIIe siècle
Illustration du XVIIe siècle vendue aux enchères Christie's
En 2009, une illustration hollandaise inédite du XVIIe siècle d'un dodo blanc et gris a été mise aux enchères par Christie's. Il était prévu de lui rapporter 6 000 £, mais elle est finalement partie pour 44 450 £. Que cette illustration ait été tirée d'un animal en peluche ou d'images antérieures reste inconnue.
L'apparence inhabituelle du dodo et son importance en tant que l'un des animaux disparus les plus célèbres ont attiré à plusieurs reprises des écrivains et des personnalités de la culture populaire.
Ainsi, l'expression "mort comme un dodo" (mort comme un dodo), qui est utilisée pour désigner quelque chose de dépassé, ainsi que le mot "dodoisme" (quelque chose d'extrêmement conservateur et réactionnaire), sont entrés dans la langue anglaise.
De même, l'idiome "togothewayoftheDodo" (suivre le chemin du dodo) a les significations suivantes : "mourir" ou "devenir obsolète", "sortir de l'usage ou de la pratique courante", ou "faire partie du passé" .
Alice et Dodo. Illustration de J. Tenniel pour le conte de fées de Lewis Carroll "Alice au pays des merveilles"
En 1865, alors même que George Clark commence à publier des rapports de fouilles de restes de dodo, l'oiseau, dont la réalité vient d'être prouvée, apparaît comme un personnage du conte de fées Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. On pense que l'auteur a inséré Dodo dans le livre, s'identifiant à lui et prenant ce nom comme pseudonyme personnel en raison d'un bégaiement, ce qui l'a amené à prononcer involontairement son vrai nom comme "Do-Do-Dodgson". La popularité du livre a fait du dodo un symbole bien connu d'extinction.
Armoiries de l'île Maurice
Aujourd'hui, le dodo est utilisé comme emblème sur de nombreux types de produits, notamment à Maurice. Le dodo est représenté sur les armoiries de ce pays en tant que porte-bouclier. De plus, l'image de sa tête apparaît sur les filigranes des billets en roupie mauricienne de toutes les coupures.
De nombreuses organisations de conservation, telles que la Conservation Foundation, utilisent l'image du dodo pour attirer l'attention sur la protection des espèces en voie de disparition. faune Parc animalier Darrell et Darrell.
Le dodo est devenu le symbole de la destruction des espèces à la suite d'une intrusion imprudente ou barbare de l'extérieur dans l'écosystème existant.
A.A. Kazdym
Liste de la littérature utilisée
Akimushkin I.I. "Mort comme un dodo" // Monde Animal : Oiseaux. Poissons, amphibiens et reptiles. Moscou: Pensée, 1995
Galushin V.M., Drozdov N.N., Ilyichev V.D., Konstantinov V.M., Kurochkin E.N., Polozov S.A., Potapov R.L., Flint V.E., Fomin V.E. . Faune du Monde : Oiseaux : Répertoire M. : Agropromizdat, 1991
Vinokourov A.A. Animaux rares et menacés. Oiseaux / édité par l'académicien V.E. Sokolov. M.: "École supérieure", 1992.
Hume J.P. Vérifiez A.S. Le dodo blanc de l'île de la Réunion : démêler un mythe scientifique et historique // Archives d'histoire naturelle. Vol. 31, n° 1, 2004
Découverte d'un squelette de dodo à l'île Maurice
Dodo Bird: Après la mort
VOUS AIMEZ LA MATIÈRE ? ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER:
Nous vous enverrons un résumé des matériaux les plus intéressants de notre site par e-mail.
Le dodo est un oiseau éteint incapable de voler qui vivait sur l'île Maurice. La première mention de cet oiseau est née grâce aux marins hollandais qui ont visité l'île à la fin du XVIe siècle. Des données plus détaillées sur l'oiseau ont été obtenues au 17ème siècle. Certains naturalistes ont longtemps considéré le dodo comme une créature mythique, mais plus tard, il s'est avéré que cet oiseau existait vraiment.
Apparence
Le dodo, connu sous le nom d'oiseau dodo, était assez grand. Les individus adultes atteignaient un poids de 20 à 25 kg et leur taille était d'environ 1 m.
Autres caractéristiques:
- corps enflé et petites ailes, indiquant l'impossibilité de voler;
- pattes courtes fortes;
- pattes à 4 doigts;
- queue courte de plusieurs plumes.
Ces oiseaux étaient lents et se déplaçaient sur le sol. Extérieurement, celui à plumes ressemblait un peu à une dinde, mais il n'y avait pas de crête sur sa tête.
La principale caractéristique est le bec crochu et l'absence de plumage près des yeux. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru que les dodos étaient apparentés aux albatros en raison de la similitude de leurs becs, mais cette opinion n'a pas été confirmée. D'autres zoologistes ont parlé d'appartenir à des oiseaux de proie, y compris des vautours, qui n'ont pas non plus de peau emplumée sur la tête.
Il est à noter que Longueur du bec du dodo mauricien mesure environ 20 cm et son extrémité est courbée vers le bas. La couleur du corps est fauve ou gris cendré. Les plumes des cuisses sont noires, tandis que celles de la poitrine et des ailes sont blanchâtres. En fait, les ailes n'étaient que leurs débuts.
Reproduction et alimentation
 Selon les scientifiques modernes, les dodos ont créé des nids à partir de branches et de feuilles de palmier, ainsi que de terre, après quoi un gros œuf a été pondu ici. Incubation pendant 7 semaines le mâle et la femelle alternaient. Ce processus, associé à l'alimentation du poussin, a duré plusieurs mois.
Selon les scientifiques modernes, les dodos ont créé des nids à partir de branches et de feuilles de palmier, ainsi que de terre, après quoi un gros œuf a été pondu ici. Incubation pendant 7 semaines le mâle et la femelle alternaient. Ce processus, associé à l'alimentation du poussin, a duré plusieurs mois.
Dans une période aussi cruciale, les dodos ne laissaient personne s'approcher du nid. Il est à noter que d'autres oiseaux ont été chassés par un dodo du même sexe. Par exemple, si une autre femelle s'approchait du nid, le mâle assis sur le nid commençait à battre des ailes et à émettre des sons forts, appelant sa femelle.
Le régime dodo était basé sur des fruits, des feuilles et des bourgeons de palmier mûrs. Les scientifiques ont pu prouver un tel type de nutrition à partir des pierres trouvées dans l'estomac des oiseaux. Ces galets remplissaient la fonction de broyer les aliments.
Restes de l'espèce et preuves de son existence
Sur le territoire mauricien, où vivait le dodo, il n'y avait pas de grands mammifères ni de prédateurs, c'est pourquoi l'oiseau est devenu confiant et très calme. Lorsque les gens ont commencé à arriver sur les îles, ils ont exterminé les dodos. De plus, des cochons, des chèvres et des chiens ont été amenés ici. Ces mammifères mangeaient des buissons où se trouvaient des nids de dodo, écrasaient leurs œufs et détruisaient les oisillons et les oiseaux adultes.
Après l'extermination définitive, il était difficile pour les scientifiques de prouver que le dodo existait réellement. L'un des spécialistes a réussi à trouver plusieurs ossements massifs sur les îles. Un peu plus tard, des fouilles à grande échelle ont été menées au même endroit. La dernière étude a été menée en 2006. C'est alors que des paléontologues hollandais trouvèrent à Maurice squelette de dodo reste :
- le bec;
- ailes;
- pattes ;
- colonne vertébrale;
- élément du fémur.
En général, le squelette d'un oiseau est considéré comme une découverte scientifique très précieuse, mais il est beaucoup plus facile de trouver ses parties qu'un œuf survivant. À ce jour, il n'a survécu qu'en un seul exemplaire. Sa valeur dépasse la valeur d'un œuf d'épiornis de Madagascar, c'est-à-dire le plus grand oiseau qui existait dans l'Antiquité.
Faits intéressants sur les oiseaux

Dodo est d'un grand intérêt par des scientifiques du monde entier. Ceci explique les nombreuses fouilles et études qui sont menées aujourd'hui sur le territoire mauricien. De plus, certains experts s'intéressent à la restauration de l'espèce par génie génétique.
On pense que les dodos ont été les premières espèces d'oiseaux que l'homme a exterminés à dessein. Mais en est-il vraiment ainsi ? Les documents de cette époque ne confirment pas l'idée fausse qui prévaut que les gens organisaient des chasses de masse pour eux. Alors qu'est-ce qui a conduit à la disparition de ces oiseaux drôles et crédules ? Hélas, un tragique accident.
Quand les Britanniques veulent dire qu'un être vivant s'est éteint assez rapidement, ils utilisent des unités phraséologiques : " mort comme un dodo", qui peut être traduit: "mort comme un dodo." Et ce n'est pas un hasard - les parents incapables de voler des pigeons de la famille Raphines, mieux connus sous le nom de dodos qui vivaient dans les îles Mascareignes, ont été exterminés avant que les zoologistes n'aient eu le temps de les étudier correctement. C'est peut-être pour cette raison que la fiabilité des informations sur ces oiseaux est dans la plupart des cas très douteuse. Le nom du dodo est encore entouré d'un grand nuage de mythes et de légendes.
Et peut-être le mythe le plus célèbre est que le dodo a été exterminé directement par les gens. Par exemple, la chasse incontrôlée de ces oiseaux sans défense a entraîné leur disparition rapide. Certes, deux autres raisons sont invoquées - la destruction de l'habitat des dodos et les dommages qui leur sont causés par des espèces animales étrangères aux Mascareignes introduites par l'homme. Cependant, tout cela est considéré comme des facteurs secondaires qui n'ont fait que tuer des oiseaux déjà en voie de disparition.
Mais en est-il vraiment ainsi ? Très probablement non. Curieusement, mais les gens mettent beaucoup moins d'efforts dans l'extinction du dodo que les rats, les chats, les cochons et les chiens. Cependant, parlons de tout dans l'ordre.
Dans n'importe quel ouvrage de référence ornithologique, vous pouvez lire qu'il existait trois types de dodos. L'un d'eux, le dodo mauricien ( Raphus cucullatus) a été étudié le plus complètement - au musée d'Oxford il y avait (hélas, mort dans un incendie) son effigie, et en plus, les biologistes ont à leur disposition plusieurs squelettes incomplets (l'un d'eux est conservé au musée Darwin de Moscou). De plus, plusieurs dodos ont été emmenés de l'île en Europe, où ils ont longtemps vécu en captivité, mais, hélas, ne se sont pas reproduits. Et beaucoup de gens les ont vus. C'est-à-dire que nous pouvons dire avec certitude à son sujet que cet oiseau a vraiment existé.
Mais avec d'autres espèces, c'est beaucoup plus difficile. Ni les dessins, ni les animaux empaillés, ni leurs squelettes ne sont à la disposition des zoologistes. Et ne l'a jamais été. Ainsi, par exemple, toutes les informations sur le dodo du désert ( Pezophaps solitaire), qui vivaient sur l'île de Rodrigues, sont limités à seulement cinq messages de capitaines de navires et de voyageurs. La description la plus détaillée en a été faite par François Lega. Cependant, même ses contemporains ont qualifié ce voyageur de menteur à 100 %. C'est pourquoi, jusqu'à présent, de nombreux scientifiques considèrent son livre "Le voyage et les aventures de François Lega et de ses compagnons..." comme un recueil de récits de fictions d'autrui.
Mais le plus étrange est que ni Lega ni d'autres naturalistes n'ont dessiné cet oiseau (malgré le fait que, selon les informations de Leg, les ermites n'avaient pas du tout peur des gens - c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à se précipiter autour de l'île pour capturer sur papier). En conséquence, jusqu'à présent, personne ne sait à quoi ressemblait réellement l'ermite. Et personne n'a jamais vu de preuves physiques, pas même une petite plume, d'un dodo de l'île Rodrigues. Même les paléontologues, qui ont récemment déterré plusieurs crânes de dodo mauricien à Maurice, n'ont rien trouvé de tel à Rodrigues.

Le rythme de son extinction est également très intéressant, si on les compare à ceux du dodo mauricien. Le Togo a été décrit pour la première fois en 1598 (rapporté par le capitaine néerlandais van Nek), et la dernière observation date de 1693. C'est-à-dire que l'espèce s'est éteinte environ cent ans avant la première étape de la colonisation de Maurice. Voyons maintenant ce qui est arrivé à l'ermite : la première rencontre a eu lieu en 1730 et la dernière en 1761. C'est-à-dire que cette espèce a été exterminée en 30 ans ! Et cela malgré le fait que Rodrigues était beaucoup moins visité par les Hollandais que Maurice. Je ne sais pas pour vous, mais toute cette histoire me semble suspecte.
Par conséquent, la question est tout à fait logique - ce dodo a-t-il existé ? Peut-être n'était-ce qu'une sorte de delirium tremens local qui apparaissait aux capitaines et aux voyageurs après avoir bu avec du rhum ? Il est difficile de croire que l'oiseau, qui, selon des témoins oculaires, était "... commun pour ces lieux", a disparu sans raison apparente pendant trente ans sans aucune trace. Ce que même les paléontologues à ce jour ne peuvent pas trouver.
Les informations sur le troisième type de dodo - blanc ou réunion ( Raphus solitaire). Ici aussi, il n'y a pas de preuves matérielles ni de dessins. Seulement trois rapports, dont le plus détaillé appartient au naturaliste Bory de Saint-Vincennes, qui fut d'ailleurs le dernier à avoir vu cet oiseau en 1801. Et pour la première fois, ils l'ont vu déjà en 1613 ! Il s'avère que ce dodo est en train de disparaître depuis près de deux cents ans. Et de manière si choquante que, comme son collègue de Rodrigues, il n'a rien laissé qui lui rappelle (y compris les paléontologues). Comme vous pouvez le voir, il y a de forts doutes que ce dodo, comme l'ermite, était un véritable animal, et non un mythe.
Mais revenons au dodo mauricien, dont personne ne doute de l'existence. C'étaient de gros oiseaux, pesant jusqu'à 15-23 kilogrammes, qui ne pouvaient pas du tout voler (en raison de la réduction de la quille sur le sternum et des ailes sous-développées). Ils vivaient dans les forêts, se nourrissant de noix et d'autres fruits tombés des arbres. Très probablement, les dodos menaient une vie solitaire, ne se connectant avec leur "moitié" que pendant le temps de l'accouplement et de l'incubation.
Tous les témoins oculaires ont noté une certaine crédulité directement pathologique des dodos (ils n'avaient pas du tout peur des gens et des animaux domestiques, mais pour les habitants de l'île, où il n'y avait pas du tout de grands prédateurs, c'est tout à fait normal), mais ils ont également dit que en cas de danger, le dodo se défendait désespérément, utilisant son bec puissant de 23 centimètres de long.
La chose la plus intéressante est que les dodos ne faisaient pas du tout de nids. La femelle a pondu son seul œuf directement sur le sol, et ainsi elle a incubé. Le mâle lui a apporté de la nourriture et a également aidé à protéger la maçonnerie de ceux qui aiment profiter des œufs (principalement des lézards et des serpents). Mais les dodos ne se souciaient pratiquement pas du poussin éclos, et il a commencé une vie indépendante assez tôt. Et, apparemment, beaucoup d'entre eux sont morts dans les premières années de la vie à la suite d'accidents et dans l'estomac de serpents.
Il s'ensuit que le nombre de dodos, apparemment, n'a jamais été particulièrement important. Par conséquent, les rapports sur des centaines d'oiseaux tués par des marins sont très probablement une invention de journalistes et de militants des droits des animaux du XXe siècle. Le fait est également que dans les journaux de bord des navires portugais, néerlandais et français de l'époque, il n'y a pas un mot sur la "récolte de dron" en masse. Bien que ces documents fassent état de la chasse et de la récolte d'énormes tortues marines.
Cependant, il ne pouvait y avoir aucun rapport de chasse au dodo car tous ceux qui ont goûté cet oiseau ont admis qu'il était pratiquement immangeable. Le capitaine néerlandais Wiebrand van Warwijk a écrit que leur viande avait un goût dégoûtant. "Il y a ces gros oiseauxétait impossible », explique le marin, qui était auparavant en mer depuis plusieurs mois et n'avait pas vu nourriture fraîche!
D'autres capitaines ont confirmé l'avis de leur collègue. Il existe même des preuves qu'il était spécifiquement interdit aux marins de chasser les dodos pour ne pas perdre de temps. Le voyageur anglais Thomas Herbert en 1634 a également donné une évaluation peu flatteuse du goût des dodos: "Ces oiseaux sont plus probablement un miracle que de la nourriture, car leurs estomacs gras, bien qu'ils puissent satisfaire la faim, avaient un goût dégoûtant et non nutritif."
Une seule chose en découle - une personne ne pouvait pas exterminer les dodos par une chasse incontrôlée, car il n'était tout simplement pas nécessaire de les chasser. La version selon laquelle les gens ont contribué à l'extinction des oiseaux en détruisant leur habitat ne tient pas non plus la route - les premières grandes plantations de l'île sont apparues dans les années 70 du XVIIe siècle, alors que le nombre de dodos avait déjà sérieusement diminué. Seule la troisième hypothèse demeure - les oiseaux ont été détruits par des animaux amenés par des humains.
Et le voici, tout à fait semblable à la vérité. Cependant, les cochons, les chats et les chiens ne sont guère responsables de l'extermination des dodos - ils vivaient avec les colons sur la côte et ne sont pas allés à l'intérieur des terres, où les dodos se cachaient principalement. Cependant, à côté d'eux, il y avait aussi des "étrangers" sur l'île. Dans les cales des navires, des gens ont accidentellement amené des rats gris sur l'île, qui l'aimaient vraiment là-bas.
Ces animaux agiles et intelligents ont immédiatement réalisé qu'il est très facile d'obtenir des poussins dodo - après tout, leurs parents ne les protègent pratiquement pas. Il est possible qu'ils aient également volé les œufs de ces oiseaux négligents. Bien sûr, personne ne l'a vu directement (les rats préfèrent voler la nuit), mais il existe des preuves indirectes que ce sont eux qui ont amené le dodo dans la tombe.
Cette histoire peut sembler fictive si elle n'était pas une réalité fabuleuse. Sur les îles désertes perdues de l'océan Indien (Maurice, Rodrigues et La Réunion, appartenant à l'archipel des Mascareignes), des oiseaux dodo, représentants de la famille des dodo, vivaient dans l'Antiquité.
Extérieurement, ils ressemblaient à des dindes, bien qu'ils soient deux ou trois fois plus gros qu'eux. Un oiseau dodo pesait 25 à 30 kg et mesurait 1 mètre. Un long cou, une tête nue, sans signe de plumage ni de crête, un bec effrayant très massif, rappelant celui d'un aigle. Des pattes à quatre doigts et une sorte d'ailes, composées de quelques plumes modestes. Et une petite crête, la soi-disant queue.
oiseau dodo confiant
L'île sur laquelle vivaient les oiseaux était vraiment un paradis : il n'y avait tout simplement pas d'humains, pas de prédateurs ou tout autre danger potentiel pour les dodos. Les oiseaux Dodo ne pouvaient pas voler, nager et courir vite, mais c'était inutile, car personne n'offensait les Dodos. Toute la nourriture était simplement sous leurs pieds, ce qui n'entraînait pas le besoin de l'obtenir, s'élevant dans les airs ou nageant à travers l'océan. Une autre caractéristique distinctive de l'oiseau dodo était son gros ventre, qui s'est formé en raison d'une existence trop passive; il a juste rampé sur le sol, ce qui a rendu le mouvement des oiseaux très lent.
mode de vie dodo
Les dodo étaient caractérisés par un mode de vie solitaire, ils s'unissaient par paires uniquement pour élever leur progéniture. Le nid, dans lequel un seul gros œuf blanc a été pondu, a été construit sous la forme d'un monticule de terre avec l'ajout de branches et de feuilles de palmier. Le processus d'incubation a duré 7 semaines et les deux oiseaux (femelle et mâle) y ont participé à tour de rôle. Les parents gardaient leur nid en tremblant, ne laissant pas les étrangers à moins de 200 mètres de lui. Il est intéressant de noter que si un dodo "extérieur" s'approchait du nid, un individu du même sexe allait le chasser.

Selon les informations de ces temps lointains (la fin du XVIIe siècle), les dodos, s'appelant, battaient bruyamment des ailes ; de plus, en 4 à 5 minutes, ils ont effectué 20 à 30 coups, ce qui a créé un bruit fort qui a été entendu à une distance de plus de 200 mètres.
Extermination brutale d'oiseaux dodo
L'idylle du dodo s'est terminée avec l'arrivée des Européens sur les îles, qui ont perçu ces proies faciles comme une excellente base de nourriture. Trois oiseaux abattus suffisaient à nourrir tout l'équipage d'un navire, et tout le voyage prenait plusieurs dizaines de dodos salés. Cependant, leur viande était considérée comme insipide par les marins, et la chasse facile au dodo (quand il suffisait de frapper un oiseau confiant avec une pierre ou un bâton) était sans intérêt. Les oiseaux, malgré le bec puissant, n'ont pas résisté et ne se sont pas enfuis, d'autant plus que leur poids excessif les en empêchait. Peu à peu, l'extraction de dodos s'est transformée en une sorte de compétition: "qui marquera plus de dodos", que l'on peut appeler en toute sécurité une extermination impitoyable et barbare de créatures naturelles inoffensives. Beaucoup ont essayé d'emporter avec eux des spécimens aussi inhabituels, mais, semble-t-il, les créatures apprivoisées ne pouvaient pas supporter la captivité qui leur était imposée: elles pleuraient, refusaient de se nourrir et finissaient par mourir. Le fait historique confirme que lorsque les oiseaux ont été emmenés de l'île en France, ils ont versé des larmes, comme s'ils se rendaient compte qu'ils ne reverraient jamais leurs terres natales.
100 années malveillantes - et pas de dodos
Les oiseaux ont reçu leur nom "dodo" (du portugais) des mêmes marins qui les considéraient comme stupides et idiots. Bien qu'en ce cas ce sont les gens de la mer qui ont agi stupidement, car une personne intelligente ne détruira pas impitoyablement une créature sans défense et unique.

Les rats de mer, les chats, les singes, les chiens et les cochons amenés sur les îles par les humains ont également participé indirectement à l'extermination des oiseaux dodo, en mangeant des œufs et des poussins. De plus, les nids étaient situés au sol, ce qui ne faisait que faciliter leur extermination par les prédateurs. En moins de 100 ans, pas un seul dodo n'est resté sur les îles. L'histoire du dodo est un exemple frappant de la façon dont une civilisation impitoyable détruit tout ce qui est donné gratuitement par la nature sur son passage.
En tant que symbole de la destruction barbare des créatures naturelles, le Jersey Animal Conservation Trust a choisi l'oiseau dodo comme emblème.
Alice au pays des merveilles - le livre à partir duquel le monde a découvert l'oiseau dodo
Comment le monde a-t-il su l'existence d'un oiseau aussi inhabituel ? Sur quelle île vivait le dodo ? Et a-t-elle vraiment existé ?
Le public a découvert les oiseaux dodo, qui pourraient longtemps rester dans l'oubli, grâce à Lewis Carroll et son conte de fées Alice au pays des merveilles. Là, l'oiseau dodo est l'un des personnages, et de nombreux critiques littéraires pensent que Lewis Carroll s'est décrit à l'image de l'oiseau dodo.

Dans le monde il y avait un dodo empaillé en un seul exemplaire ; en 1637, ils ont réussi à amener un oiseau vivant des îles en Angleterre, où pendant longtemps ils ont gagné de l'argent en montrant un spécimen aussi inhabituel. Après la mort, un animal en peluche a été fabriqué à partir d'une curiosité à plumes, qui a été placée au Musée de Londres en 1656. En 1755, il a été gâché par le temps, les mites et les insectes, alors le conservateur du musée a décidé de le brûler. Au dernier moment avant «l'exécution», l'un des employés du musée a arraché la jambe et la tête de l'animal en peluche (ils sont les mieux conservés), qui sont devenus des reliques inestimables du monde de la zoologie.