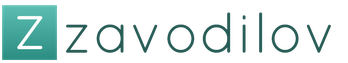Terre magique ! Là autrefois,
La satire est un dirigeant courageux,
Fonvizin, ami de la liberté, a brillé...
A.S. Pouchkine
Courageux maître de la satire, écrivain de grand talent, artiste impitoyable dans sa vérité, Denis Ivanovitch Fonvizine fut le fondateur du réalisme russe. "Il a lancé la ligne la plus magnifique et, peut-être, la plus socialement fructueuse de la littérature russe - la ligne réaliste accusatrice", a écrit A. M. Gorky. Dans ses œuvres, Fonvizine expose magistralement les vices de la classe dirigeante, lutte contre l'autocratie russe, reflète toute la gamme des mœurs de son époque contemporaine et exprime une forte montée de la conscience nationale du peuple. Son regard attentif et observateur notait tous les détails désagréables de la réalité environnante : corruption et anarchie des tribunaux, bassesse du caractère moral des nobles, favoritisme encouragé par les plus hautes autorités. Tous ces vices de la société étaient certainement soumis à sa satire bien ciblée.
Même au début activité créative Fonvizine se rapproche des jeunes écrivains et éditeurs progressistes. Le résultat de la communication avec eux fut le poème «Message à mes serviteurs Choumilov, Vanka et Petrouchka», dans lequel les fondements de l'enseignement de l'Église et les défenseurs de la religion, prêchant la sagesse divine dans la création du monde et de l'homme, furent ridiculisés. L’auteur, avec une franche ironie, a dénoncé les mensonges et l’hypocrisie des codes moraux officiels :
Les prêtres cherchent à tromper le peuple,
Les serviteurs du majordome, les majordomes du maître,
Les uns les autres sont des messieurs et de nobles boyards
Souvent, ils veulent tromper le souverain ;
Et chacun, pour mieux remplir sa poche,
Pour le bien, il a décidé de se livrer à la tromperie.
Fonvizin n'était pas intéressé à démontrer des vices abstraits, mais à révéler la vie réelle des représentants de la « classe noble ». Ainsi, dans la comédie « Le Brigadier », il montre l'apathie mentale et le manque de spiritualité, la stupidité et la cruauté, l'égoïsme et la débauche qui règnent dans la société. Derrière la décence extérieure des héros se cache l'apparence prédatrice des propriétaires, prêts à se ronger la gorge. Le brigadier et le conseiller étaient en service dans le passé. Mais le service n'était pour eux qu'un moyen d'atteindre un seul objectif : évolution de carrière, propre bénéfice.
Il n'y a pas d'introduction artificielle d'éléments comiques dans les œuvres du satiriste. Leur objet devient la vraie vie, la pure vérité. Les images créées sont typiques, leur langage et leur comportement sont pleinement cohérents avec l'environnement et l'époque. Un tableau frappant de l’ignorance sauvage et de l’arbitraire des nobles locaux est présenté dans les « Lettres à Falaley ». Selon l'auteur, le comportement immoral des héros les transforme en une sorte de bête, renforcée par une passion aveugle pour les animaux et, parallèlement, par une cruauté envers les serfs, qu'ils ne considèrent pas du tout comme des personnes.
L’écrivain présente une évaluation audacieuse du règne de Catherine, exposant toutes ses lacunes dans « Discours sur les lois indispensables de l’État ». L'auteur aborde ici la question des relations entre le peuple et le souverain. Il exprime sa profonde confiance dans le fait qu'« il ne peut pas contrôler avec gloire les autres qui ne peuvent pas se contrôler lui-même », indiquant ainsi clairement qu'il n'approuve pas la politique et le comportement des autorités. Selon lui, Catherine n'a pas rempli Tâche principale dirigeante - "n'a pas introduit de règles indispensables dans son État", sans lesquelles il n'y a aucune garantie qu'elle ne rendrait pas elle-même son gouvernement autocratique et tyrannique.
Véritable fils de son temps, D.I. Fonvizine fut l'un des personnages marquants du XVIIIe siècle. Tout au long de sa carrière, il a défendu les idéaux élevés de justice et d’humanisme. Dans toutes ses œuvres résonnent certainement une protestation courageuse contre l’injustice de l’autocratie, une dénonciation colérique des abus du servage. Et la satire audacieuse devint son arme précise et fidèle.
Yu. Stennik. Satires du brave dirigeant
Source : Fonvizin D.I. Favoris. - M., 1983. - P. 5-22. -
Le XVIIIe siècle dans l'histoire de la littérature russe a laissé beaucoup de choses remarquables. Mais s'il était nécessaire de nommer un écrivain dans les œuvres duquel la profondeur de la réalisation de la morale de son époque serait à la mesure du courage et de l'habileté à dénoncer les vices de la classe dirigeante, alors un tel écrivain devrait d'abord être nommé Denis Ivanovitch Fonvizine.
Fonvizine est entré dans l'histoire de la littérature nationale en tant qu'auteur de la célèbre comédie "Le Mineur". Mais il était aussi un prosateur talentueux. Le don d'un satiriste se combinait en lui avec le tempérament d'un publiciste né. L'impératrice Catherine II craignait le sarcasme flagellant de la satire de Fonvizine. Le talent artistique inégalé de Fonvizine a été remarqué à son époque par Pouchkine. Cela nous touche encore aujourd’hui.
Étant l’une des figures les plus marquantes du mouvement éducatif en Russie au XVIIIe siècle, Fonvizine incarne dans son œuvre la montée de la conscience nationale qui marque cette époque. Dans le vaste pays réveillé par les réformes de Pierre, les meilleurs représentants de la noblesse russe deviennent les porte-parole de cette conscience renouvelée. Fonvizin percevait particulièrement vivement les idées de l'humanisme des Lumières ; avec une douleur au cœur, il observait la dévastation morale d'une partie de sa classe. Fonvizin lui-même vivait sous l'emprise d'idées sur les devoirs moraux élevés d'un noble. Dans l'oubli des nobles de leur devoir envers la société, il voyait la cause de tous les maux publics : « Il m'est arrivé de voyager dans mon pays, j'ai vu dans ce que la plupart de ceux qui portaient le nom d'un noble mettaient leur curiosité. ceux qui servent, ou qui, d'ailleurs, n'occupent des postes dans le service que parce qu'ils montent à deux. J'en ai vu beaucoup d'autres qui ont immédiatement démissionné dès qu'ils ont obtenu le droit d'atteler les quatre. J'ai vu des descendants méprisants des ancêtres les plus respectables. mot, j'ai vu des nobles serviles, et c'est pour cela que mon cœur s'est déchiré. C'est ce qu'écrivait Fonvizine en 1783 dans une lettre à l'auteur des « Faits et Fables », c'est-à-dire à l'impératrice Catherine II elle-même.
Fonvizin entre dans la vie littéraire au moment où Catherine II suscite l'intérêt pour les idées des Lumières européennes : elle flirte d'abord avec les éclaireurs français - Voltaire, Diderot, D'Alembert Mais très vite il ne reste plus aucune trace du libéralisme de Catherine.
Par la volonté des circonstances, Fonvizine se retrouve au cœur de la lutte politique interne qui éclate à la cour dans les années 1770. Dans cette lutte, Fonvizine, doué d'une brillante créativité et d'un sens aigu de l'observation, se substitue à un écrivain satirique qui dénonçait la corruption et l'anarchie dans les tribunaux, la bassesse du caractère moral des nobles proches du trône et le favoritisme encouragé par les plus hautes autorités. .
N. I. Novikov avec ses revues satiriques "Drone" (1769-1770) et "Peintre" (1772), Fonvizin avec ses discours journalistiques et l'immortel "Mineur" (1782) et, enfin, A. N. Radichtchev avec le célèbre " Voyage de Saint-Pétersbourg ". Saint-Pétersbourg à Moscou" (1790) - tels sont les jalons de la formation de la tradition de la ligne la plus radicale des nobles Lumières russes, et ce n'est pas un hasard si chacun des trois écrivains marquants de l'époque a été persécuté par le gouvernement. Dans les activités de ces écrivains, les conditions préalables à cette première vague du mouvement de libération anti-autocratique à la fin du premier quart du XIXe siècle, que V.I. Lénine a appelé une étape dans le développement de la noble pensée révolutionnaire, ont mûri.
Fonvizin est né à Moscou le 3 (14) avril 1745 (selon d'autres sources - 1744) dans une famille noble aux revenus moyens. Déjà dans son enfance, Denis Ivanovitch a reçu de son père, Ivan Andreevich Fonvizin, les premières leçons d'une attitude intransigeante envers la flagornerie et la corruption. Il était un homme merveilleux. "Personne ne l'a vu parmi les principaux nobles de cette époque", se souviendra plus tard Fonvizine, "personne ne l'a vu". Désintéressé et direct, il ne tolérait pas les mensonges, « détestait l'extorsion et, ayant été dans des endroits où les gens gagnent de l'argent (ayant pris sa retraite du service militaire en 1762, Ivan Andreevich a servi dans la commission de révision. - Yu. S.), je ne l'ai jamais fait Je n'accepte pas de cadeaux.
Et le jeune Fonvizin a absorbé une qualité supplémentaire de son père : l'intolérance envers le mal et la violence. Rappelant le caractère colérique mais impitoyable de son père, Fonvizine a noté qu’il « traitait toujours les domestiques avec douceur, mais malgré cela, il n’y avait pas de mauvaises personnes dans notre maison. Cela prouve que les coups ne sont pas un moyen de réformer les gens ». Fonvizine se souviendra également des préoccupations infatigables d'Ivan Andreïevitch concernant l'éducation et l'éducation morale de ses enfants, qui, outre l'aîné Denis, étaient sept autres dans la famille. Certains traits de caractère de mon père s’incarneront dans les caractères positifs de ses œuvres. Ainsi, les pensées du Père Fonvizine se font entendre dans les instructions morales de Starodum, l'un des personnages principaux de la comédie « Le Mineur » - le summum de la satire éducative russe du XVIIIe siècle et du drame russe de ce siècle.
La vie de Fonvizine n’a pas été riche en événements extérieurs. Étudiant au noble gymnase de l'Université de Moscou, où il fut affecté à l'âge de dix ans et qu'il termina avec succès au printemps 1762. Service au Collège des Affaires étrangères, d'abord sous le commandement du conseiller d'État de la Chancellerie du Palais I.P. Elagin, puis, à partir de 1769, comme l'un des secrétaires du chancelier comte N.I. Panin. La démission qui suivit au printemps 1782. En 1762-1763, 1777-1778, 1784-1785, 1787, Fonvizin part en voyage à l'étranger, d'abord en mission officielle, puis principalement pour se soigner. Ces dernières années, entravé par une grave maladie, il se consacre entièrement à la littérature. Contemporain de la Grande Révolution bourgeoise française, Fonvizine est décédé à une époque où, effrayée par les événements en France, Catherine II déclenchait une répression cruelle contre les représentants du mouvement éducatif en Russie. Il mourut le 1er décembre 1792 et fut enterré au cimetière Lazarevski de la Laure Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg.
Derrière ce maigre aperçu de faits biographiques externes se cache la vie de l'un des écrivains russes les plus originaux et les plus courageux du XVIIIe siècle, pleine de tensions internes et d'un riche contenu spirituel. Arrêtons-nous sur les différentes étapes de son parcours créatif.
Les premières représentations littéraires de Fonvizine remontent à la période de son séjour au gymnase universitaire. Fonvizin a reçu de bonnes connaissances au gymnase langues étrangères, « et surtout... le goût des sciences verbales ». Il a commencé son parcours d'écrivain par des traductions. En 1761, l'imprimerie de l'Université de Moscou publia un livre intitulé « Fables moralisantes avec explications de M. Baron Golberg, traduites par Denis Fonvizine ». La traduction du livre a été commandée pour le jeune homme par le libraire de la librairie universitaire. Les œuvres de Ludwig Holberg, le plus grand écrivain danois du XVIIIe siècle, étaient très populaires en Europe, notamment ses comédies et ses pamphlets satiriques. Ils ont été transférés à différentes langues, y compris en Russie. D’ailleurs, l’influence d’une des comédies de Golberg, « Jean-Français », qui faisait la satire de la Gallomanie, se reflétera à sa manière sur le concept de la comédie de Fonvizin « Le Brigadier », qu’il écrira en 1768-1769.
Sur les 251 fables, Fonvizine en sélectionna 183 pour la traduction (plus tard, lors de la deuxième édition en 1765, 42 autres fables furent ajoutées). La forme prosaïque et le caractère édifiant des enseignements moraux étaient typiques des fables du XVIIIe siècle. Malgré le pathétique moralisateur abstrait de la plupart des pièces de la collection, il y avait parmi elles des baspies, rappelant une blague populaire ou une miniature satirique pleine d'esprit, où le ridicule critique dépassait souvent une simple blague innocente. Et puis les sympathies démocratiques de l’auteur ont donné aux fables une forte résonance sociale.
« L'âne a acheté la noblesse et a commencé à en être fier devant ses camarades. La pie, ayant entendu cela, dit : « Il est impossible qu'une créature aussi stupide en soit fière, et lui, avec toute sa noblesse. , restera toujours un âne stupide » (fable 136, « L'âne-noble ») Ainsi, sous le couvert de l'allégorie, l'arrogance des parvenus est ridiculisée. les absurdités des lois non écrites du pouvoir, et bien plus encore. Nous pouvons affirmer avec certitude que la traduction du livre de fables de Golberg fut pour le jeune Fonvizin la première école d'humanisme pédagogique, semant l'âme du futur écrivain pour la satire sociale.
Au cours des années 1761-1762, Fonvizin publia plusieurs autres de ses traductions mineures dans des publications universitaires. Puis il traduit en vers la tragédie de Voltaire « Alzira » et, enfin, se tourne vers la traduction du vaste roman didactique d'aventure de l'abbé J. Terrason « La vertu héroïque, ou la vie de Seth, roi d'Égypte, tirée du mystérieux témoignage de L'Egypte ancienne." La première partie fut déjà publiée en 1762, mais le travail de traduction dura encore six ans.
L'année 1762 marque un tournant dans le destin de Fonvizin. Au printemps, il était inscrit comme étudiant, mais il n'était pas obligé d'étudier à l'université. En septembre, l'impératrice arrive à Moscou pour le couronnement avec toute la cour et les ministres. C’est précisément à ce moment-là que le collège étranger avait besoin de jeunes traducteurs. Fonvizin, dix-sept ans, reçoit une offre flatteuse du vice-chancelier prince A.M. Golitsyn d'entrer dans le service puis, en octobre 1762, soumet une pétition adressée à Catherine II. La pétition était accompagnée d'échantillons de ses traductions en trois langues ; Latin, allemand et français. Après avoir passé les contrôles nécessaires, Fonvizine a été jugé « capable de gérer les affaires de ce conseil ». À l'été 1763, après les célébrations du couronnement, la cour retourna à Saint-Pétersbourg et Fonvizine s'installa dans la capitale avec la cour.
La période pétersbourgeoise de la vie de Fonvizine commença. On peut juger de son contenu à partir de la correspondance de l'écrivain avec ses proches restés à Moscou et ses souvenirs personnels, selon les notes des contemporains. L'exécution des missions de traduction et la conduite de la correspondance officielle alternent avec la présence obligatoire aux réceptions officielles à la cour (kurtags), aux mascarades et aux théâtres. Mais la vie de cour pèse lourdement sur Fonvizine. Au début, retenus, au fil des années, de plus en plus persistants dans ses lettres à sa famille, des motifs de solitude et de rejet de l'agitation sordide de la vie sociale commencent à résonner. "J'ai vraiment ressenti un terrible dégoût pour toutes les absurdités dans lesquelles les gens du monde d'aujourd'hui placent leur principal plaisir. Je crois que mon bonheur réside dans un calme que, vivant sans toi, je ne peux bien sûr pas ressentir", note-t-il dans un communiqué. lettre à ses parents à l'été 1768. Deux années vont encore s'écouler, mais Fonvizine ne s'habituera toujours pas à son poste de fonctionnaire judiciaire. « Quant à moi, sachez, ma mère, écrit-il à sa sœur en 1770, que la vie de cour me manque beaucoup. Vous savez si j'ai été créé pour cela... »
Malgré sa charge de travail, Fonvizine s'intéresse vivement à littérature moderne. Il visite souvent le salon littéraire des époux Myatlev, célèbre à Saint-Pétersbourg, où il rencontre A.P. Sumarokov, M.M. Maykov, I.S. Barkov et d'autres. Les contemporains de Fonvizine notent à propos de ces rencontres : « L'ardeur de son esprit, son expression débridée et acérée ont toujours irrité et exaspéré tout le monde, mais avec tout cela, tout le monde l'aimait. Encore plus tôt, Fonvizin a rencontré le fondateur du théâtre russe F. Volkov. La communication avec les cercles théâtraux de la capitale a contribué au rapprochement de Fonvizine avec le premier acteur du théâtre de cour I. A. Dmitrevsky, dont l'amitié ne s'est rompue qu'à la fin de sa vie. C'est Dmitrevsky qui fut le premier interprète du rôle de Starodum lors de la production de "Le Mineur" en 1782.
L'amitié de Fonvizine avec le jeune écrivain F.A. Kozlovsky le conduit dans le cercle de la jeunesse noble de Saint-Pétersbourg, friande de libre pensée et de voltairianisme. La composition du célèbre poème de Fonvizine «Message à mes serviteurs - Choumilov, Vanka et Petrouchka» remonte à l'époque de sa connaissance de Kozlovsky. Son contenu est imprégné d’une pure ironie, dénonçant les mensonges et l’hypocrisie des statuts de la morale officielle. L'auteur se tourne un à un vers ses serviteurs avec une question avec laquelle la pensée philosophique se débat depuis des siècles : quel est le but de l'univers, « dans quel but cette lumière a-t-elle été créée ? Et les réponses des domestiques sonnent comme une satire caustique sur état actuel société. L'accusateur central est le cocher Vanka. Il voyage beaucoup et a donc vu beaucoup de choses. La tromperie et l’avidité universelles sont, selon lui, la loi unique et déterminante de la vie :
Les prêtres cherchent à tromper le peuple,
Les serviteurs du majordome, les majordomes du maître,
Les uns les autres sont des messieurs et de nobles boyards
Souvent, ils veulent tromper le souverain ;
Et chacun, pour mieux remplir sa poche,
Pour le bien, il a décidé de se livrer à la tromperie.
Le pathétique anticlérical de la satire a valu à l'auteur des accusations d'athéisme. En effet, dans la littérature du XVIIIe siècle, il y a peu d'ouvrages où l'intérêt personnel des bergers spirituels, corrompant le peuple, serait si clairement exposé. "Pour l'argent du plus haut créateur || Le berger et les brebis sont prêts à tromper !" - Vanka résume ses observations.
Le premier grand succès littéraire de Fonvizine est venu avec sa comédie "Le Brigadier". Le tournant de Fonvizin vers le théâtre a été facilité non seulement par son amour passionné pour le théâtre, mais aussi par certaines circonstances de nature militaire. En 1763, il fut nommé secrétaire « pour certaines questions » auprès du conseiller d'État I. P. Elagin. Ce noble, qui était au bureau du palais « à la réception des pétitions », était en même temps directeur de « la musique et du théâtre de la cour ». Dans les cercles littéraires de Saint-Pétersbourg, il était connu comme poète et traducteur. Au milieu des années 1760, un cercle de jeunes amateurs de théâtre se rassembla autour d'Elagin, dont faisait partie Fonvizin. Les membres du cercle réfléchissent sérieusement à mettre à jour le répertoire national de la comédie. Les comédies russes avaient auparavant été écrites par Sumarokov seul, mais elles étaient également de nature imitative. Dans ses pièces, les personnages portaient des noms étrangers, l'intrigue était menée par les serviteurs omniprésents, qui ridiculisaient les maîtres et organisaient leur bonheur personnel. La vie sur scène se déroulait selon des canons incompréhensibles et étrangers au peuple russe. Tout cela, selon les jeunes auteurs, limitait les fonctions éducatives du théâtre, qu'ils plaçaient à l'avant-garde de l'art théâtral. Comme l'a écrit le théoricien du cercle d'Elagin V.I. Lukin, "de nombreux spectateurs de comédies ne reçoivent aucune correction dans la morale des autres. Ils pensent que ce ne sont pas eux, mais les étrangers qui sont ridiculisés". Dans un effort pour rapprocher le plus possible le théâtre des besoins de la vie sociale russe, Lukin a proposé une voie de compromis. L’essence de sa réforme était d’« inciter les comédies étrangères à se conformer par tous les moyens possibles à nos coutumes ». Une telle «déclinaison», ou plutôt une adaptation des pièces d'autrui, signifiait remplacer les noms étrangers des personnages par des noms russes, transférer l'action dans un cadre correspondant aux mœurs et coutumes nationales, et enfin amener le discours des personnages plus proche des normes de la langue russe parlée. Lukin a activement mis tout cela en pratique dans ses comédies.
Fonvizine a également rendu hommage à la méthode consistant à « plier » les pièces d’Europe occidentale à la morale russe. En 1763, il écrit la comédie poétique « Corion », reprenant le drame « Sydney » de l'auteur français L. Gresset. Cependant, la pièce n'a pas réussi à se rapprocher complètement de la morale russe. Bien que l’action de la comédie de Fonvizine se déroule dans un village près de Moscou, l’histoire sentimentale de Corion et Zénovie, séparées par un malentendu et unies dans le final, ne pouvait devenir la base d’une comédie véritablement nationale. Son intrigue était marquée par une forte touche de convention mélodramatique, caractéristique des traditions du drame bourgeois des « larmes ». La comédie "Corion" a été jouée avec succès sur la scène du théâtre de cour, mais pour Fonvizin lui-même, ce n'était que sa première épreuve de force dans le domaine du théâtre. La véritable reconnaissance du talent dramatique de Fonvizine vint avec la création de la comédie « Le Brigadier » en 1768-1769. C'était le résultat de la recherche d'une comédie originale russe que vivaient les membres du cercle d'Elagin, et en même temps je portais en moi de nouveaux principes profondément novateurs de l'art dramatique en général. Proclamés en France, dans les traités théoriques de D. Diderot, ces principes ont contribué au rapprochement du théâtre avec la réalité.
Dès le lever du rideau, le spectateur s'est retrouvé immergé dans un environnement qui émerveillait par la réalité de la vie. Dans une image paisible confort de la maison tout est significatif et en même temps tout est naturel - la décoration rustique de la pièce, les vêtements des personnages, leurs activités et même les touches individuelles de comportement. Tout cela correspondait aux innovations scéniques du théâtre Diderot.
Mais il y avait un point important qui séparait les positions créatives des deux dramaturges. La théorie théâtrale de Diderot, née à la veille de la révolution bourgeoise française, reflétait les goûts et les exigences du spectateur de troisième classe, affirmant à sa manière l'importance de l'homme moyen, celui idéaux moraux, qui ont été générés par le mode de vie modeste d'un simple travailleur. Il s’agissait d’une étape innovante, impliquant une révision de nombreuses idées traditionnelles, auparavant reconnues comme inébranlables, sur la fonction du théâtre et les limites de l’art.
Fonvizine ne pouvait naturellement pas suivre mécaniquement le programme des pièces de Diderot, car les conflits moraux du drame de Diderot n'étaient pas soutenus par les conditions réelles de la vie sociale russe. Il adopte l'exigence de fidélité à la nature de Diderot, mais subordonne ce principe artistique à d'autres tâches. Le centre de gravité des enjeux idéologiques dans la comédie de Fonvizine s’est déplacé vers le plan satirique et accusateur.
Un brigadier à la retraite arrive chez le conseiller avec sa femme et son fils Ivan, que ses parents marient à la fille du propriétaire Sophia. Sophia elle-même aime le pauvre noble Dobrolyubov, mais personne ne tient compte de ses sentiments. "Donc, si Dieu bénit, le mariage aura lieu le 26" - ces paroles du père de Sophia commencent la pièce.
Tous les personnages de « Le Brigadier » sont des nobles russes. Dans l'atmosphère modeste et quotidienne de la vie locale moyenne, la personnalité de chaque personnage apparaît comme au fil des conversations. Progressivement, d'action en action, les intérêts spirituels des personnages se révèlent sous différents angles, et pas à pas l'originalité des solutions artistiques trouvées par Fonvizin dans sa pièce innovante se révèle.
Le conflit traditionnel du genre comique entre une fille vertueuse et intelligente et un marié stupide qui lui est imposé est compliqué par une circonstance. Ivan a récemment visité Paris et est plein de mépris pour tout ce qui l'entoure à la maison, y compris ses parents. « Quiconque est allé à Paris, avoue-t-il, a le droit, lorsqu'il parle des Russes, de ne pas s'inclure parmi ceux-là, car il est déjà devenu plus Français que Russe. » Le discours d’Ivan regorge de mots français prononcés au bon moment et de manière inappropriée. La seule personne avec laquelle il trouve un langage commun est le Conseiller, qui a grandi en lisant romans d'amour et devenir fou de tout ce qui est français.
Le comportement absurde du nouveau « Parisien » et du conseiller, qui en est ravi, suggère que le fondement du plan idéologique de la comédie est la dénonciation de la gallomanie. Avec leurs bavardages inutiles et leurs manières inédites, ils semblent s’opposer aux parents d’Ivan et au conseiller, qui possèdent une grande expérience de la vie. Cependant, la lutte contre la gallomanie n'est qu'une partie du programme accusateur qui alimente le pathétique satirique du "Brigadier". La parenté d'Ivan avec tous les autres personnages est révélée par le dramaturge dès le premier acte, où ils dénoncent les dangers de la grammaire : chacun d'eux considère que l'étude de la grammaire est inutile, elle n'ajoute rien à la capacité de réussite ; rangs et richesse.
Cette nouvelle chaîne de révélations, révélant les horizons intellectuels des personnages principaux de la comédie, nous amène à comprendre l'idée principale de la pièce. Dans un environnement où règnent l’apathie mentale et le manque de spiritualité, la familiarisation avec la culture européenne s’avère être une caricature maléfique des Lumières. La misère morale d'Ivan, fier de son mépris pour ses compatriotes, n'a d'égale que sa laideur spirituelle ; le reste, car leur morale et leur manière de penser sont, au fond, tout aussi basses.
Et ce qui est important, c'est que dans la comédie, cette idée se révèle non pas de manière déclarative, mais à travers la révélation psychologique des personnages. Si auparavant les tâches de la satire comique étaient conçues principalement en termes de démonstration sur scène d'un vice personnifié, par exemple « l'avarice », la « mauvaise langue », la « vantardise », maintenant, sous la plume de Fonvizine, le contenu des vices est socialement concrétisé. L'emphase satirique de la « comédie de personnages » de Sumarokov cède la place à une étude comiquement pointue des mœurs de la société. Et c’est là le sens principal du « brigadier » de Fonvizine.
Fonvizin a trouvé un moyen intéressant de rehausser le pathétique satirique et accusateur de la comédie. Dans "Le Brigadier", l'authenticité quotidienne des caractéristiques du portrait des personnages s'est transformée en un grotesque comiquement caricatural. La comédie de l'action augmente de scène en scène grâce à un kaléidoscope dynamique d'épisodes d'amour entrelacés. Le flirt vulgaire à la manière laïque du gallomane Ivan et du conseiller cède la place à la cour hypocrite du conseiller pour l'incompréhensible brigadier, puis le brigadier lui-même envahit le cœur du conseiller avec une franchise militaire. La rivalité entre père et fils menace de dégénérer en bagarre, et seule une révélation générale calme tous les « amants » malchanceux.
Le succès du "Brigadier" a fait de Fonvizine l'un des écrivains les plus célèbres de son temps. Le chef du camp éducatif de la littérature russe des années 1760, N. I. Novikov, a fait l'éloge de la nouvelle comédie du jeune auteur dans sa revue satirique « Truten ». En collaboration avec Novikov, Fonvizin définit enfin sa place dans la littérature en tant que satiriste et publiciste. Ce n'est pas un hasard si dans son autre magazine "Peintre" de 1772, Novikov a publié l'essai satirique le plus pointu de Fonvizine "Lettres à Falaley", ainsi que "Un mot pour le rétablissement de Son Altesse le Tsarévitch et du Grand-Duc Pavel Petrovich en 1771" - un essai dans lequel, dans le genre du panégyrique officiel adressé à l'héritier du trône, est exposée la pratique du favoritisme et de l'autoglorification adoptée par Catherine II.
Dans ces écrits, on peut déjà discerner les grandes lignes du programme idéologique et des orientations créatives qui détermineront plus tard l'originalité artistique du Mineur. D'une part, dans les «Lettres à Falalei» - cette image vivante de l'ignorance sauvage et de l'arbitraire des nobles locaux - Fonvizin découvre et utilise magistralement pour la première fois une technique constructive spéciale de dénonciation satirique des propriétaires de serfs. L'immoralité du comportement des personnages dénoncés dans les lettres les transforme, selon le satiriste, en ressemblances avec des bêtes. Leur perte de l’apparence humaine est accentuée par la passion aveugle qu’ils éprouvent pour les animaux, tout en ne considérant pas leurs serfs comme des êtres humains. Telle est, par exemple, la structure des pensées et des sentiments de la mère de Fadaleya, pour qui, après son fils, la chienne lévrière Naletka est la créature la plus aimée. La bonne mère ne ménage pas les verges pour faire subir à ses paysans l'agacement de la mort de sa chienne bien-aimée. Le personnage de la mère de Falaleya nous amène directement à l'image du personnage principal de "Le Mineur" - Mme Prostakova. Cette méthode de caractérisation psychologique des héros sera particulièrement utilisée dans la figure grotesque de l'oncle Mitrofan - Skotiin.
En revanche, dans la « Parole de redressement… » sont déjà énoncées les conditions préalables au programme politique que Fonvizine développera plus tard dans le célèbre « Discours sur les lois indispensables de l’État » : « L’amour du peuple est le véritable gloire des souverains. Soyez maître de vos passions et rappelez-vous que celui qui ne peut pas se contrôler lui-même ne peut pas contrôler les autres avec gloire..." Comme nous le verrons ci-dessous, le pathos des pensées des personnages positifs de "Le Mineur" Starodum. et Pravdin se nourrit largement des idées contenues dans les œuvres citées.
L'intérêt de Fonvizin pour le journalisme politique n'était pas accidentel. En décembre 1769, tout en restant fonctionnaire du Collège des Affaires étrangères, Fonvizin, sur proposition du comte N.I Panin, entra à son service, devenant secrétaire du chancelier. Et pendant près de 13 ans, jusqu'à sa retraite en 1782, Fonvizine resta le plus proche assistant de Panine, jouissant de sa confiance illimitée.
Le chef du département de la politique étrangère russe fut jusqu'en 1773 le tuteur du tsarévitch et, en même temps, pendant toutes ces années, il dirigea l'opposition politique interne à Catherine II. Le chancelier plaçait ses espoirs dans le retrait de Catherine, qui était montée illégalement sur le trône, dès la majorité de l'héritier, qui devait avoir lieu à l'automne 1772. Pour l’éducateur Fonvizine, qui croyait au pouvoir transformateur de l’éducation et à un monarque raisonnable et éclairé, promouvoir les projets de Panine signifiait se consacrer au service de la patrie. C'est pourquoi il s'engage dans la lutte politique, en s'exprimant avec des ouvrages journalistiques pointus, imprégnés d'une tendance clairement visible.
L'automne 1772 approchait. Mais transférer le trône à son fils ne faisait pas partie des plans de l’impératrice. En reportant d'un an la célébration de la majorité de Paul sous prétexte de son prochain mariage, Catherine a réussi à se sortir d'une situation difficile. En septembre 1773, le mariage eut lieu. Désormais, l’influence de Panin sur l’héritier fut limitée, car avec le mariage, l’éducation était considérée comme terminée. La campagne d’intrigues politiques que Fonvizine dut observer à la veille du mariage du tsarévitch l’obligea à nouveau à affronter les mœurs de la vie de cour. "Il n'est pas nécessaire de décrire la dépravation ici", notait-il dans une lettre à sa sœur en août 1773. "Aucune ordonnance avare ne contient des intrigues juridiques telles que celles qui se produisent constamment dans notre cour."
En août 1777, Fonvizin part en voyage à l'étranger. Son chemin se dirigeait vers la France – à travers la Pologne, la Saxe et les petites principautés allemandes. A Montpellier, l'épouse de Fonvizin a dû suivre un traitement. En février 1778, Fonvizin arrive à Paris et y reste jusqu'à la fin de l'été. Pendant son séjour en France, l'écrivain a tenu un journal détaillé (« journal »), où il a enregistré toutes ses impressions liées à sa connaissance du pays. Bien que le « journal » de Fonvizine n'ait pas survécu, certaines de ses notes nous sont parvenues dans les textes des lettres qu'il envoyait régulièrement en Russie à sa sœur Fedosya Ivanovna et au comte N.I. Panin. Dans ces lettres, Fonvizine apparaît non seulement comme un voyageur curieux, mais comme un homme d'État intéressé par la structure sociopolitique de la France, le système éducatif de ce pays, la position de la noblesse française et l'état de l'économie. . "Si j'ai trouvé quelque chose en France dans un état florissant, alors, bien sûr, leurs usines et manufactures. Il n'y a aucune nation au monde qui ait un esprit aussi inventif que les Français dans les arts et métiers qui concernent le goût." A Montpellier, Fonvizin suit des cours de droit français auprès d'un avocat. Ses réflexions sur cette question sont encore aujourd’hui frappantes par leur perspicacité. « Le système de lois de cet État est un édifice, pourrait-on dire, sage, construit au fil de nombreux siècles et d'esprits rares », écrit-il dans une lettre datée du 24 décembre 1777, « mais les divers abus et corruptions de mœurs qui se sont glissés petit à petit, nous avons atteint l'extrême extrême<...>Le premier droit de tout Français est la liberté ; mais son véritable état actuel est l'esclavage, car un pauvre ne peut gagner sa nourriture que par le travail d'esclave, et s'il veut user de sa précieuse liberté, il devra mourir de faim. En un mot, la liberté est un nom vide de sens, et le droit du fort reste le droit au-dessus de toutes les lois. » Fonvizin s'intéresse particulièrement à la situation de la noblesse française. Il explique l'appauvrissement et l'ignorance de la classe dirigeante par la toute-puissance de le clergé et l'absence bon systèmeéducation, Il y relie le déclin général de la vertu qu'il a observé dans la société, la soif universelle de l'intérêt personnel. « L’amour de l’intérêt personnel a infecté de manière indescriptible tous les États, sans exclure les philosophes mêmes du siècle actuel. »
L'écrivain russe, qui a eu l'occasion de voir de ses propres yeux le pays - le pionnier et la façon de penser de toute l'Europe éclairée, observe avec curiosité la vie culturelle de la France et nous en laisse une description. A Paris, il assiste à une réunion de l'Académie française ; rencontre Marmontel, A. Thomas, D'Alembert voit Voltaire à plusieurs reprises, songe à rencontrer J.-J. Rousseau est également invité à une réunion de la Société des écrivains et artistes, où il fait une présentation sur les propriétés. de la langue russe. Il suscite l’admiration pour son théâtre français : « Les représentations ici sont on ne peut plus parfaites.<...>Celui qui n'a pas vu la comédie à Paris n'a aucune idée directe de ce qu'est la comédie" ; "On ne peut pas, en la regardant, s'oublier au point de ne pas la considérer comme l'histoire vraie qui se passe à ce moment-là."
De retour de France, Fonvizin perçoit des problèmes urgents de société et vie politique propre pays. C'est en y réfléchissant qu'est née l'idée de « Le Mineur », dont le travail a apparemment duré plusieurs années. À la fin de 1781, la pièce était terminée. Cette comédie a absorbé toute l'expérience accumulée par le dramaturge plus tôt, et en termes de profondeur des problèmes idéologiques, de courage et d'originalité des solutions artistiques trouvées, elle reste un chef-d'œuvre inégalé du drame russe du XVIIIe siècle. Le pathétique accusateur du contenu de « Le Mineur » est alimenté par deux sources puissantes, également dissoutes dans la structure de l'action dramatique. Ce sont la satire et le journalisme. Une satire destructrice et impitoyable remplit toutes les scènes illustrant le mode de vie de la famille Prostakova. Dans les scènes de l'enseignement de Mitrofan, dans les révélations de son oncle sur son amour pour les cochons, dans l'avidité et l'arbitraire de la maîtresse de maison, le monde des Prostakov et des Skotinins se révèle dans toute la laideur de sa misère spirituelle.
Mais un verdict tout aussi dévastateur sur ce monde est prononcé par un groupe de nobles positifs présents sur scène, dont la vision de la vie contraste avec l'existence bestiale des parents de Mitrofan. Dialogues entre Starodum et Pravdin, qui touchent à des sujets profonds, parfois problèmes de gouvernement, sont des discours journalistiques passionnés contenant la position de l'auteur. Le pathétique des discours de Starodum et Pravdin remplit également une fonction accusatrice, mais ici l'exposition se confond avec l'affirmation des idéaux positifs de l'auteur.
Deux problèmes qui inquiétaient particulièrement Fonvizine sont au cœur du « Mineur ». C'est avant tout le problème de la décadence morale de la noblesse. Selon les mots de Starodum, dénonçant avec indignation les nobles ; «dont la noblesse, pourrait-on dire, a été enterrée avec leurs ancêtres», dans ses observations rapportées de la vie de cour, Fonvizin ne se contente pas de constater le déclin des fondements moraux de la société - il cherche les raisons de ce déclin.
DANS littérature scientifique un lien direct a été noté à plusieurs reprises entre les déclarations de Starodum et Pravdin et dispositions clés L'essai de Fonvizine « Discours sur les lois indispensables de l'État », écrit simultanément avec « Mineure ». Ce traité journalistique a été conçu comme une introduction au projet préparé à la fin des années 1770 par N.I. Droits fondamentaux, irremplaçable à tout moment par toute autorité », conçu à son tour pour l'événement de l'accession au trône du tsarévitch Pavel Petrovitch. « La raison commune et l'expérience de tous les siècles montrent que les bonnes mœurs du souverain constituent seules les bonnes mœurs du peuple. Dans ses mains se trouve le ressort avec lequel orienter les gens : vers la vertu ou vers le vice. » Ces mots du « Discours sur les lois indispensables de l’État » peuvent servir de commentaire à un certain nombre de déclarations de Starodum. Puisque la vertu de ses sujets est déterminée par la « bonne conduite » du souverain, alors la responsabilité lui incombe du fait que la « mauvaise morale » domine dans la société.
La remarque finale de Starodum, qui termine « Le Mineur » : « Ce sont les fruits dignes du mal ! - dans le contexte des dispositions idéologiques du traité de Fonvizine, donne à l'ensemble de la pièce une consonance politique particulière. Pouvoir illimité des propriétaires terriens sur leurs paysans en l'absence de exemple moral de la part des plus hautes autorités est devenu une source d'arbitraire, cela a conduit la noblesse à oublier ses devoirs et ses principes d'honneur de classe, c'est-à-dire à une dégénérescence spirituelle la classe dirigeante. À la lumière du concept moral et politique général de Fonvizine, dont les représentants dans la pièce étaient des personnages positifs, le monde des Prostakov et des Skotiin apparaissait comme une réalisation inquiétante du triomphe du mal.
Un autre problème du « Sous-bois » est celui de l’éducation. Au sens assez large, l’éducation était, dans l’esprit des penseurs du XVIIIe siècle, considérée comme le principal facteur déterminant le caractère moral d’une personne. Dans les idées de Fonvizine, le problème de l’éducation devenait importance nationale, parce que la seule source fiable, à son avis, de salut contre le mal qui menace la société - la dégradation spirituelle de la noblesse - était enracinée dans une éducation correcte.
Une partie importante de l'action dramatique de « Le Mineur » est, à un degré ou à un autre, projetée vers la résolution du problème de l'éducation. Les scènes de l’enseignement de Mitrofan et l’écrasante majorité des enseignements moraux de Starodum lui sont subordonnées. Le point culminant du développement de ce thème est sans aucun doute la scène de l’interrogatoire de Mitrofan dans le 4ème acte de la comédie. Cette image satirique, meurtrière par la puissance du sarcasme accusateur qu'elle contient, sert de verdict sur le système éducatif des Prostakov et des Skotinine. Le prononcé de ce verdict est assuré non seulement de l’intérieur, grâce à la révélation de l’ignorance de Mitrofan, mais aussi grâce à la démonstration sur scène d’exemples d’une éducation différente. Nous parlons des scènes dans lesquelles Starodum parle avec Sophia et Milon.
Avec la production de "Le Mineur", Fonvizin a dû connaître beaucoup de déceptions. La représentation prévue au printemps 1782 dans la capitale fut annulée. Et seulement à l'automne, le 24 septembre de la même année, grâce à l'aide du tout-puissant G. A. Potemkine, la comédie fut représentée dans un théâtre en bois de la prairie de Tsaritsyne par les acteurs du théâtre de cour. Fonvizin lui-même a participé à l'apprentissage des rôles des acteurs et a été impliqué dans tous les détails de la production. La représentation a été une totale réussite. Selon un contemporain, « le public applaudissait la pièce en lançant des bourses ». Le public était particulièrement sensible aux allusions politiques cachées dans les discours de Starodum.
Avant même la production de « Le Mineur », Fonvizine décide de démissionner. Il a motivé sa demande par les maux de tête fréquents dont l'écrivain a souffert tout au long de sa vie. Mais la véritable raison de sa démission était, apparemment, la conviction définitive de l'inutilité de son service à la cour. A cette époque, N.I. Panin était déjà gravement malade. Les projets visant à retirer l'impératrice du pouvoir et les espoirs de voir le prince héritier sur le trône ne semblaient pas destinés à se réaliser. Le 7 mars 1782, Fonvizine présente une démission officielle, que Catherine II signe immédiatement. L'écrivain a désormais la possibilité de se consacrer entièrement à la créativité.
En 1783, l’Académie russe est créée. Ses tâches comprenaient la préparation d'un rapport complet dictionnaire explicatif Langue russe. Fonvizin faisait partie de ceux qui étaient chargés d'élaborer les règles de compilation du dictionnaire. S'appuyant sur sa connaissance d'exemples français de dictionnaires de ce type, Fonvizine a préparé un projet de règles : « Inscription pour l'élaboration d'un dictionnaire explicatif de la langue slave-russe ». Il servit plus tard de base à un guide de travaux pratiques sur le dictionnaire. Parallèlement, l'écrivain est invité à collaborer à la nouvelle revue « L'Interlocuteur des amoureux de la parole russe » née sous les auspices de l'Académie russe. Bien que le magazine soit contrôlé par Catherine II, sa direction n'a généralement pas de caractère officiel.
Dès le premier numéro de Sobesednik, Fonvizine avait commencé à publier « L’expérience d’un homme des domaines russe ». Sous couvert d'un dictionnaire explicatif de synonymes russes, Fonvizine propose aux lecteurs une satire politique savamment déguisée. Le modèle externe de cet ouvrage était le dictionnaire français des synonymes de l'abbé Girard. Certains articles ont simplement été traduits à partir de là. Mais l'essentiel du choix de la composition lexicale, sans parler de l'interprétation, appartenait à Fonvizin lui-même. Voici comment, par exemple, Fonvizine illustre la définition des sens de la série synonyme - oublier, oublier, vouer à l'oubli : « On peut oublier le nom d'un juge qui vole, mais il est difficile d'oublier qu'il est un voleur, et la justice elle-même est obligée de ne pas vouer le crime à l’oubli. Les convictions éducatives de l'auteur donnent à ses articles un ton journalistique brillant et, dans certains cas, les commentaires du dictionnaire se transforment en essais satiriques miniatures.
Parmi les autres documents satiriques placés par Fonvizine dans « L'Interlocuteur », il faut citer « Pétition à Minerve russe des écrivains russes » - cachée derrière la stylisation allégorique du document officiel, une révélation de l'ignorance des nobles persécutant les écrivains ; « Le sermon prononcé lors de la Journée spirituelle par le prêtre Vasily dans le village de P*** », s'opposant parodiquement à la prédication de la littérature ; «Le récit des sourds-muets imaginaires» est une tentative d'utiliser la structure d'un roman européen picaresque à des fins satiriques, qui, malheureusement, est restée inachevée.
Le discours le plus sérieux de Fonvizine dans les pages de ce magazine a été la publication des fameuses « Questions qui peuvent susciter une attention particulière chez les personnes intelligentes et honnêtes ». Des "questions" ont été envoyées à "l'interlocuteur" de manière anonyme. En fait, il s’agissait d’un défi tacite lancé au mécène sacré de la revue, et Catherine II dut accepter ce défi. Au début, elle ne savait pas qui était l'auteur des Questions. La nature de ses réponses montre clairement qu'elle a parfaitement saisi leur orientation critique. Essentiellement, les « Questions » de Fonvizine représentaient une forme ingénieusement trouvée de critique de certains aspects de la politique intérieure du gouvernement, car elles attiraient l’attention sur les problèmes les plus urgents de la vie sociale de la Russie à cette époque. "Pourquoi l'effort principal d'une grande partie des nobles n'est-il pas de faire rapidement de leurs enfants des gens, mais d'en faire rapidement des sous-officiers sans servir dans la garde ?" - a dit la 7ème question. "Pourquoi n'avons-nous pas honte de ne rien faire ?" - a dit la 12ème question. Dans de nombreux cas, Catherine s'en sort avec des excuses, comme par exemple la réponse à la 7ème question (« Une chose est plus facile que l'autre ») ou fait semblant de ne pas comprendre, comme ce fut le cas en répondant à la 12ème question. ("Ce n'est pas clair : c'est dommage de faire quelque chose de mal, mais pour vivre en société, ne mange pas, ne fais rien"). Mais dans certaines réponses, la fierté blessée du monarque s’est traduite par des cris irrités et intolérants. L'impératrice était particulièrement en colère contre la 14ème question : « Pourquoi autrefois les bouffons, les escrocs et les bouffons n'avaient-ils pas de rangs, mais maintenant ils en ont des très élevés ? Catherine a en fait évité de répondre directement à cette question, mais elle a accompagné sa remarque d'une note menaçante : « NB : Cette question est née de la liberté d'expression, que nos ancêtres n'avaient pas, ils auraient commencé par la question actuelle avec dix anciennes.
Fonvizin contraint sans doute l'impératrice à se défendre. Et quelles que soient ses tentatives pour réduire la gravité des problèmes, pour en transformer certains en bagatelles, pour ses contemporains, le sens de la controverse était clair. Apparemment, l'écrivain a pris conscience de l'irritation de Catherine et, dans l'un des prochains numéros de « L'Interlocuteur », Fonvizine a publié une lettre « À l'auteur de « Faits et fables » de la part de l'auteur des questions », dans laquelle il a tenté de s'expliquer ouvertement. son. L'Impératrice n'a pardonné au satiriste son insolence qu'à la fin de sa vie, imposant une interdiction semi-officielle de publication de ses œuvres.
À l'été 1784, Fonvizin et sa femme voyagent à nouveau à l'étranger, cette fois en Italie. Et lors de ce voyage, Fonvizin a tenu un journal détaillé, en partie conservé dans les lettres qu'il envoyait régulièrement à sa sœur et à P.I. Panin. Fin connaisseur d'art, Fonvizin parle avec enthousiasme dans ses lettres des chefs-d'œuvre de la peinture et de l'architecture italiennes.
Les Fonvizin séjournent en Italie tout l'hiver et tout le printemps 1785. Déjà pendant le voyage, Fonvizin a dû souffrir d'une grave maladie à Rome. Mais l'arrivée à Moscou a été éclipsée par un nouveau coup dur : Fonvizine a été frappé par la paralysie. Le traitement à Moscou n'a donné aucun résultat. Le traitement des eaux de Carlsbad a duré près d'un an, avec des interruptions. À l'automne 1787, s'étant quelque peu rétabli, Fonvizine retourna à Saint-Pétersbourg.
Apparemment, avant même de partir pour l'Italie, Fonvizin a créé une œuvre originale sur un terrain ancien. Il s'agissait du récit « grec » « Callisthenes », publié anonymement dans la revue « New Monthly Works » en 1786. L'intrigue de l'histoire remonte à l'histoire de la vie du philosophe grec stoïcien, élève d'Aristote, à la cour d'Alexandre le Grand. Le sens allégorique de cette satire politique est évident. Étranger à l’intérêt personnel et à la flatterie, le « héraut de la vérité » Callisthène est vaincu à la cour du monarque conquérant, qui s’est déclaré dieu. Calomnié par l'un des favoris d'Alexandre, le philosophe meurt torturé en prison.
L'histoire "Callisthène" est marquée par un profond pessimisme. Il montre clairement la déception de l'auteur face aux illusions éducatives associées aux espoirs d'un monarque vertueux, gouvernant selon les lois de la bonté et de la justice.
Le dernier grand projet de Fonvizine dans le domaine de la prose satirique, qui ne s'est malheureusement pas réalisé, fut le magazine "Ami des gens honnêtes, ou Starodum". Fonvizin eut l'idée de le publier en 1788. Il était prévu de publier 12 numéros au cours de l'année. Dans un avertissement aux lecteurs, l'auteur a informé que sa revue serait publiée « sous la direction de l'auteur de la comédie « Minor », ce qui semble indiquer la continuité idéologique de son nouveau projet.
Le magazine s'est ouvert sur une lettre à Starodum de « l'auteur de Nedorosl », dans laquelle l'éditeur s'adressait à un « ami des honnêtes gens » en lui demandant de l'aider en lui envoyant des documents et des pensées « qui, par leur importance et leur moralité, seront séduira sans aucun doute les lecteurs russes.» Dans sa réponse, Starodum non seulement approuve la décision de l'auteur, mais l'informe également immédiatement de l'envoi de lettres reçues de « connaissances », promettant de continuer à lui fournir le matériel nécessaire : la lettre de Sophia à Starodum. , sa réponse, ainsi que "Lettre de Taras Skotinine à sa propre sœur Mme Prostakova" et étaient apparemment censés constituer le premier numéro du magazine.
La lettre de Skotinine est particulièrement impressionnante par son pathétique accusateur. L'oncle Mitrofan, déjà familier aux contemporains de l'écrivain, informe sa sœur de la perte irréparable qu'il a subie : son cochon hétéroclite bien-aimé, Aksinya, est décédé. Dans la bouche de Skotinin, la mort d'un cochon apparaît comme un événement rempli d'une profonde tragédie. Ce malheur a tellement choqué Skotinine que maintenant, avoue-t-il à sa sœur, « je veux m'en tenir à l'enseignement moral, c'est-à-dire corriger les mœurs de mes serfs et de mes paysans ».<...>bouleau.<...>Et je veux que l’effet d’une si grande perte sur moi soit ressenti par tous ceux qui dépendent de moi. » Cette petite lettre satirique sonne comme un verdict de colère contre l’ensemble du système de tyrannie féodale.
Les documents ultérieurs, également « transférés » à l'éditeur du magazine par Starodum, n'étaient pas moins poignants. Il s’agit avant tout de la « Grammaire générale de la Cour » – un brillant exemple de satire politique qui a exposé la morale de la cour.
Tant en service que dans ses communications personnelles, Fonvizin a eu l'occasion de découvrir plus d'une fois le véritable prix de la noblesse des nobles proches du trône et d'étudier les lois non écrites de la vie à la cour. Et maintenant, lorsqu'un écrivain à la retraite, déjà malade, aborde ce sujet dans le magazine satirique qu'il a conçu, ses propres observations de vie lui serviront de matériau. "Qu'est-ce qu'un mensonge judiciaire ?" - le satiriste posera la question. Et la réponse sera : « Il y a une expression d'une âme basse devant une âme arrogante. Elle consiste en un éloge éhonté du grand maître pour les services qu'il n'a pas rendus et pour les vertus qu'il n'a pas. » Ce n’est pas un hasard si A. N. Radichtchev, dans son célèbre « Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou », a utilisé la satire de Fonvizine pour caractériser un certain « Son Excellence » dans le chapitre « Zavidovo ».
Un pamphlet cinglant dénonçant le système judiciaire de la Russie féodale était également une sélection vaste dans son sens et dans son style inhabituellement coloré, qui comprenait «Une lettre trouvée après la mort bienheureuse du conseiller de la cour Vzyatkine, à feu Son Excellence ***». , et joint à la lettre « Bref registre » (une liste de cas qui promettent un profit à Son Excellence) et la « Réponse » de Son Excellence à la lettre de Vzyatkin. Ce triptyque satirique unique a révélé un tableau horrible d’abus et de pots-de-vin généralisés dans les tribunaux et l’administration en raison de l’immoralité de l’élite dirigeante et de la corruption de l’appareil d’État.
Ainsi, le magazine conçu par Fonvizine était censé perpétuer les meilleures traditions du magazine satirique russe de la fin des années 1760. Ce n’est pas un hasard si le sous-titre du magazine disait : « Essai périodique consacré à la vérité ». Mais il était inutile de compter sur le consentement de la censure de Catherine pour publier une telle publication. Par décision du conseil du doyenné, l'impression du magazine a été interdite. Ses parties individuelles étaient distribuées sous forme de listes manuscrites. (Ce n'est qu'en 1830, dans les premiers ouvrages collectifs de l'écrivain publiés par Pl. Beketov, que la plupart des documents survivants du magazine Fonvizinsko ont été publiés.) Un an plus tard, l'écrivain tente d'organiser la publication d'un autre magazine, désormais collectif, «Moscou travaille». Mais la période de réaction politique qui suivit, liée au début de la Grande Révolution bourgeoise en France, rendit cette publication impossible.
Durant les trois dernières années de sa vie, Fonvizine fut gravement malade. En 1791, il subit quatre attaques d'apoplexie. Constatant les répressions qui s'abattent sur ses confrères éducateurs, seul, persécuté par la censure et, de plus, connaissant des difficultés financières dues à la malhonnêteté des locataires de ses domaines, Fonvizin est en état de dépression nerveuse. Ses dernières œuvres sont imprégnées de motifs de repentance religieuse. Les plus significatifs d'entre eux sont « La franche confession de mes actes et de mes pensées » (1791).
Dans ce récit autobiographique conçu en quatre livres, Fonvizin suit l'exemple de J.-J. Rousseau avec ses célèbres Confessions. "Un test de conscience" - c'est ainsi que l'auteur définit le contenu de son histoire. Année après année, à partir de souvenirs de sa petite enfance et d'histoires touchantes sur ses parents, Fonvizin revient sur son passé. Premiers cours de lecture de livres paroissiaux, études au gymnase universitaire, service auprès d'Elagin, premiers débuts littéraires. Le récit se termine par les événements de 1769, marqués par le succès retentissant de la comédie « Le Brigadier ». L'aveu d'une personne gravement malade laisse une empreinte sur l'ensemble de l'œuvre, dictant une certaine sélectivité des faits rapportés et une appréciation particulière des moments les plus importants, à son avis, de sa vie morale.
Fonvizine n'a quitté sa plume que derniers jours vie. Il a également écrit une comédie en trois actes, « The Tutor's Choice ». A propos de la lecture de cette comédie dans la maison de Derjavin le 30 novembre 1792, la veille de la mort du grand satiriste, la nouvelle a été conservée dans les mémoires de I. I. Dmitriev (Dmitriev I. I. A Look at My Life. M., 1866, pp. 58-59) .
Fils de son temps, Fonvizine, avec toute son apparence et la direction de sa quête créatrice, appartenait à ce cercle de Russes avancés du XVIIIe siècle qui formaient le camp des éclaireurs. Tous étaient des écrivains et leur œuvre était imprégnée du pathos de l’affirmation des idéaux de justice et d’humanisme. La satire et le journalisme étaient leurs armes. Des protestations courageuses contre les injustices de l'autocratie et des accusations colériques contre les abus féodaux ont été entendues dans leurs œuvres. C'est là le mérite historique de la satire russe du XVIIIe siècle, dont l'un des représentants les plus éminents était D. I. Fonvizine.
Remarques
1. Viazemsky L. A. Fon-Vizin. Saint-Pétersbourg, 1848, p. 244.
2. Loukine. V. I. et Elchaninov B. E. Œuvres et traductions, Saint-Pétersbourg, 1868.
Terre magique ! là-bas autrefois,
Satires du brave souverain,
Fonvizin, ami de la liberté, a brillé...
A. Pouchkine
Le XVIIIe siècle a laissé de nombreux noms marquants dans l’histoire de la littérature russe. Mais s'il était nécessaire de nommer un écrivain dans les œuvres duquel la profondeur de la compréhension de la morale de son époque serait à la mesure du courage et de l'habileté à dénoncer les vices de la classe dirigeante, il faudrait tout d'abord mentionner Denis Ivanovitch Fonvizine.
Fonvizine est entré dans l'histoire de la littérature nationale en tant qu'auteur de la célèbre comédie "Le Mineur". Mais il était aussi un prosateur talentueux. Le don d'un satiriste se combinait en lui avec le tempérament d'un publiciste né. L'impératrice Catherine II craignait le sarcasme flagellant de la satire de Fonvizine. Le talent artistique inégalé de Fonvizine a été remarqué à son époque par Pouchkine. Cela nous touche encore aujourd’hui.
Étant l’une des figures les plus marquantes de l’humanisme éducatif en Russie au XVIIIe siècle, Fonvizine a incarné dans son œuvre la montée de la conscience nationale qui a marqué cette époque. Dans le vaste pays réveillé par les réformes de Pierre, les meilleurs représentants de la noblesse russe deviennent les porte-parole de cette conscience renouvelée. Fonvizin percevait particulièrement vivement les idées de l'humanisme des Lumières ; avec une douleur au cœur, il observait la dévastation morale d'une partie de sa classe. Fonvizin lui-même vivait sous l'emprise d'idées sur les devoirs moraux élevés d'un noble. Dans l'oubli des nobles de leur devoir envers la société, il voyait la cause de tous les maux publics : « Il m'est arrivé de voyager dans mon pays, j'ai vu dans ce que la plupart de ceux qui portaient le nom d'un noble mettaient leur curiosité. ceux qui servent, ou qui, d'ailleurs, n'occupent des postes dans le service que parce qu'ils montent à deux. J'en ai vu beaucoup d'autres qui ont immédiatement démissionné dès qu'ils ont obtenu le droit d'atteler les quatre. J'ai vu des descendants méprisants des ancêtres les plus respectables. mot, j'ai vu des nobles serviles, et c'est pour cela que mon cœur s'est déchiré. C'est ce qu'écrivait Fonvizine en 1783 dans une lettre à l'auteur des « Faits et Fables », c'est-à-dire à l'impératrice Catherine I elle-même.
Fonvizine s'est impliquée dans la vie littéraire de la Russie à une époque où Catherine II encourageait l'intérêt pour les idées des Lumières européennes : au début, elle flirtait avec les éclaireurs français - Voltaire, Diderot, D'Alembert Mais très vite, il n'en resta plus aucune trace. du libéralisme de Catherine.
Par la volonté des circonstances, Fonvizine se retrouve au cœur de la lutte politique interne qui éclate à la cour. Dans cette lutte, Fonvizine, doué d'une brillante créativité et d'un sens aigu de l'observation, se substitue à un écrivain satirique qui dénonçait la corruption et l'anarchie dans les tribunaux, la bassesse du caractère moral des nobles proches du trône et le favoritisme encouragé par les plus hautes autorités. .
N. I. Novikov avec ses magazines satiriques "Drone" et "Painter", Fonvizin avec ses discours journalistiques et l'immortel "Nedorosl" et, enfin, A. N. Radishchev avec le célèbre "Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou" - tels sont les jalons de l'histoire formation de la tradition la ligne la plus radicale des nobles Lumières russes, et ce n'est pas un hasard si chacun des trois écrivains marquants de l'époque a été persécuté par le gouvernement. Dans les activités de ces écrivains, les conditions préalables à cette première vague du mouvement de libération anti-autocratique, qui fut plus tard appelée l'étape du développement de la noble pensée révolutionnaire, ont mûri.
Il me semble que ce n’est pas sans raison que le grand écrivain et poète russe Alexandre Sergueïevitch Pouchkine a surnommé Denis Ivanovitch Fonvizine « le brave seigneur de la satire ». C'est Fonvizine qui, à une époque, fonda un mouvement littéraire tel que le réalisme russe. Dans son œuvre, l'écrivain a réussi à faire ressortir les vices de la société, en particulier des classes dirigeantes de Russie. Il luttait contre l’injustice et l’arbitraire de l’État. Fonvizin était un écrivain étonnamment observateur ; il a réussi à refléter dans son travail ces domaines problématiques de la société dont personne n'avait parlé avant lui. Dès qu’il voyait une manifestation d’anarchie et d’injustice, une nouvelle satire très précise sortait de sa plume, la dénonçant.
Denis Ivanovitch Fonvizin n'a pas eu à inventer les personnages de ses œuvres - il a observé leurs vices et lui-même dans sa vie. L'écrivain a essayé de montrer à ses lecteurs comment le manque de concepts sur la moralité et la moralité « amère » une personne et la transforme en un animal stupide. C'est de là, selon l'auteur, que vient la cruauté injustifiée des propriétaires terriens envers leurs serfs.
J'aime beaucoup la satire de Denis Ivanovitch Fonvizine. Il était honnête avec ses lecteurs et n'avait pas peur de la responsabilité de ses œuvres, il apportait la vérité aux gens ! Et, à mon humble avis, il avait tout à fait raison lorsqu’il appelait Fonvizine « le brave seigneur de la satire ». Impossible de mieux le décrire !
Parmi les jeunes hommes décrits dans la célèbre ode de Lomonossov de 1747, qui aiment la science et veulent servir la nouvelle Russie dans ce domaine, on voit le noble russe et descendant des chevaliers allemands Denis Ivanovitch Fonvizine (1745-1792), un brillant dramaturge. et prosateur. Il entra au gymnase de l'Université de Moscou, puis, sous le patronage de I.I. Shuvalov, devint son élève, joua sur la scène du théâtre amateur local et commença très tôt des études littéraires, publiant ses traductions de l'allemand. Le jeune Fonvizin a beaucoup appris du professeur allemand intelligent et compétent I. Reichel et a montré une capacité extraordinaire pour les langues étrangères.
Mais personne au XVIIIe siècle n’a écrit de théâtre et de prose dans une langue populaire aussi vivante et organique que cet Allemand russifié, que Pouchkine appelait avec justesse « des Russes aux Russes ». La ligne générale de la satire russe commence avec Fonvizine et mène, à travers son jeune contemporain et digne héritier Krylov, à Gogol, Chchedrine et Boulgakov. Ce dramaturge a rendu sa comédie sociale vraiment populaire, le rire - son personnage principal et révélateur des vices nationaux, et le théâtre russe - la chaire à partir de laquelle il s'est ensuite adressé à notre public et.
Fonvizine a suivi la voie des Lumières tracée par Lomonossov, mais en a choisi une parmi son système des «trois calmes» - l'élément de la parole russe vivante, que la noblesse, en particulier les provinciaux, le clergé et les roturiers instruits ont continué à parler. Plus précisément, le dramaturge a créé le langage du drame russe, le comprenant correctement comme l'art des mots et un miroir de la société et de l'homme. Il ne considérait pas du tout ce langage idéal et définitif, ni ses héros comme des personnages positifs. En tant que membre de l'Académie russe, l'écrivain s'est sérieusement engagé dans l'étude et l'amélioration de sa langue contemporaine.
La satire de Fonvizin s'adresse à la fois aux gens et à leur langage (cela se voit déjà dans le premier «Brigadier», où le contremaître et le contremaître ignorants et grossiers avec leurs dictons archaïques, et leur stupide fils francisé Ivanushka et le conseiller-fashionista mièvre sont tout aussi drôle), de plus, elle utilise habilement leur langage comme outil de caractérisation satirique. Mais le dramaturge a voulu dépeindre, c'est-à-dire forcer ses contemporains vivants et leur langage oral authentique à agir et à parler sur scène. Et déjà dans "Brigadier", il a complètement réussi. Le patron éclairé et patron de Fonvizine, le comte N.I. Panin, après avoir lu une comédie à la cour du tsarévitch Pavel Petrovich, a fait remarquer à juste titre à l'auteur : « Vous connaissez très bien nos mœurs, car le brigadier est votre parent envers tout le monde... Ceci est la première comédie de nos mœurs.
Le théâtre du classicisme, où régnaient la tragédie pseudo-historique française en vers et ses imitations russes, ne pouvait pas incarner les idées innovantes du dramaturge Fonvizin et la satire était alors considérée comme le genre de littérature le plus bas ; L'écrivain savait nouvelle Russie et a compris la nature du théâtre en tant que spectacle public, parmi ses amis se trouvaient les meilleurs acteurs de l'époque F.G. Volkov et I.A. Dmitrevsky, le futur interprète du rôle de Starodum. Fonvizine lui-même avait un don extraordinaire d'acteur et de lecteur. D'où l'immense succès de sa première comédie « Le Brigadier » (1768-1769), qui fut lue par l'auteur à l'impératrice, au tsarévitch Pavel Petrovitch et à de nombreux nobles et mise en scène au théâtre de la cour.
Une intrigue fascinante qui se développe rapidement, des remarques acerbes, des situations comiques audacieuses, le langage parlé individualisé des personnages, une satire vicieuse de la noblesse russe, le ridicule des fruits des Lumières françaises - tout cela était nouveau et attrayant et en même temps familier. , reconnaissable des auditeurs et téléspectateurs de « Le Brigadier » " Le jeune Fonvizine s'en prend à la société noble et à ses vices, fruits de la demi-lumière, ulcère de l'ignorance et du servage qui frappent les esprits et les âmes. Il a montré ce sombre royaume comme un bastion de tyrannie sévère, de cruauté quotidienne, d'immoralité et de manque de culture. Le théâtre en tant que moyen de satire publique sociale nécessitait des personnages et un langage compréhensibles pour le public, des problèmes urgents du moment et des conflits reconnaissables. Tout cela se trouve dans la célèbre comédie de Fonvizine « Le Mineur », toujours jouée aujourd’hui.
La comédie a été écrite entre 1779 et 1781 et mise en scène en 1782. A cette époque, Fonvizin avait déjà terminé sa carrière officielle et judiciaire et fut contraint de démissionner avec le rang considérable de conseiller d'État. Au service du Collège des Affaires étrangères, il fut main droite Le vice-chancelier N.I. Panin, qui est en fait le premier vice-ministre des Affaires étrangères, a largement déterminé la politique étrangère de l'Empire russe. Fonvizin était apprécié et rapproché de lui par l'héritier intelligent et éclairé du trône, Pavel Petrovich. Au début, l'impératrice Catherine, elle-même écrivain et comédienne, était favorablement disposée à l'égard de l'auteur spirituel du «Brigadier».
Mais des apparitions audacieuses dans des magazines, une proximité dangereuse avec l'héritier du trône en disgrâce, la princesse E.R. Dashkova, le comte G. Orlov et le chef de l'opposition anti-Catherine Panin, un conflit politique et personnel avec le tout-puissant ont empêché la cour et la carrière littéraire de Fonvizine et finalement l'a brouillé avec l'impératrice suspecte qui, comme Pouchkine l'a noté à juste titre, avait peur de son influence sur les affaires de l'État et du talent impitoyable d'un satiriste. Cela a également été aidé par la langue acérée de l'écrivain moqueur.
L’auteur du « Brigadier » lui-même a également changé. Sa fascination de jeunesse pour les idées des éclaireurs français a cédé la place à la déception et au scepticisme après son voyage en France en 1777-1778. Et enfin, le soulèvement de Pougatchev a forcé Fonvizine à reconsidérer beaucoup de ses idées et idéaux éducatifs ; il doutait de la noblesse russe en tant que force progressiste de la société, de sa capacité même à éclairer et à gérer efficacement son immense État - militaro-féodal. Empire russe, leurs domaines et leurs paysans.
Tout cela s'est reflété dans la comédie « folklorique » (Pouchkine) « Mineur ». Cependant, les contemporains, la voyant au théâtre, ont d'abord ri de bon cœur, puis ont été horrifiés, ont éprouvé une profonde tristesse et ont appelé une pièce drôle Tragédie russe moderne de Fonvizin. Pouchkine nous a laissé le témoignage le plus précieux sur le public de cette époque : « Ma grand-mère m'a dit que pendant la représentation de Nedoroslya, il y avait eu un béguin au théâtre - les fils des Prostakov et des Skotinins, venus au service des villages des steppes. , étaient présents ici - et, par conséquent, ils ont vu devant eux des parents et des amis, votre famille." La comédie de Fonvizine était un fidèle miroir satirique, auquel il n'y a rien à reprocher. "La force de l'impression est qu'elle est composée de deux éléments opposés : le rire au théâtre est remplacé par une réflexion lourde à la sortie", a écrit l'historien V.O Klyuchevsky à propos de "Le Mineur". C’est exactement l’impact de « L’Inspecteur général » de Gogol sur le public.
Gogol, l'élève et héritier de Fonvizine, a qualifié à juste titre « Le Mineur » de véritable comédie sociale : « La comédie de Fonvizine étonne par la brutalité brutale de l'homme, résultat d'une longue stagnation insensible et choquante dans les coins reculés et les backwaters de la Russie... Il y a rien de caricatural là-dedans : tout est pris vivant de la nature et vérifié par la connaissance de l'âme. » Le réalisme et la satire aident l'auteur de la comédie à parler du sort de l'éducation en Russie. Fonvizine, par la bouche de Starodum, a qualifié l'éducation de « clé du bien-être de l'État ». Et toutes les circonstances comiques et tragiques qu'il a décrites et les caractères mêmes des personnages négatifs peuvent être qualifiés en toute sécurité de fruits de l'ignorance et du mal.
Car, après avoir visité le domaine des nobles Prostakov, le spectateur a vu toute la noble Russie dans sa tyrannie, son manque de respect pour la loi et les droits d'autrui, son ignorance bien-pensante, sa cupidité, une sorte de cruauté naïve et quotidienne. ruse égoïste. La « formation » du sous-marin Mitrofan et de son pseudo-professeur, le cocher allemand Vralman, le sergent à la retraite Tsifirkin et le séminariste Kuteikin, a montré tout le déclin de l'éducation russe, qui a conduit au déclin moral des nobles, à leur oubli de leur position principale et honorable - service à la patrie. Le père du petit garçon ne peut pas lire la lettre de Starodum car il est analphabète. Et le nom même de l'oncle Taras Skotinine et son amour sans limites pour les cochons indiquent clairement les limites extrêmes de cet grossissement et de cette dégradation morale.
Notons que « Le Mineur » commence directement par une conversation sur l’enseignement, un jeu plein d’esprit sur le dicton populaire sur le caftan de Trishkin. Mme Prostakova sérieusement, avec son entêtement naïf caractéristique, assure au serf tailleur insouciant Trishka qu'apprendre à coudre des caftans n'est pas du tout nécessaire. Déjà Pierre le Grand était confronté à une méfiance et à une aversion sévères à l'égard de tout enseignement, cette particularité nationale de ses sujets paresseux, et sous peine de punition, il les obligeait à étudier. On sait que son décret s'est heurté à une résistance cachée mais désespérée de la part des nobles, qui, comme Mitrofanushka, ne voyaient que une punition dans l'enseignement, qui considéraient la science inutile, une affaire non noble.
Dans la comédie de Fonvizine, on trouve des traces évidentes de cette résistance obstinée : le corrompu illettré, le père de Prostakova et de Taras Skotinine, a déclaré : « Je maudirai le petit garçon qui prend tout aux infidèles ». Sa fille est plus rusée, elle comprend que son fils gâté et paresseux Mitrofanushka doit au moins d'une manière ou d'une autre répondre aux exigences formelles du gouvernement pour un noble, mais elle lui enseigne également formellement, sans déranger « l'enfant » trop âgé avec le fardeau de des connaissances sérieuses et lui donna des « professeurs » semi-alphabètes, des oncles serfs et des nounous : « Les gens vivent et ont vécu sans science ». Selon l'opinion décisive de Prostakova, il existe des sciences stupides et non nobles, inutiles et inutiles pour un noble, comme la géographie, la science des chauffeurs de taxi.
Autrement dit, Mitrofanushka, paresseux et arrogant, mais très intelligent du monde, n'apprend pas les sciences et les règles morales, mais l'immoralité, la tromperie, le manque de respect pour son devoir de noble et pour son propre père, la capacité de contourner toutes les lois et règles de la société. et l'État pour son propre confort et son bénéfice. Cet homme grossier et paresseux n'est pas stupide, il est aussi rusé, il pense pratiquement, il voit que le bien-être matériel des Prostakov ne dépend pas de leur illumination et de leur zèle officiel, mais de l'audace intrépide de sa mère, de la volonté de son père. la corruption, le vol intelligent de sa parente éloignée Sophia et le vol impitoyable de ses paysans. Pourquoi devrait-il étudier assidûment et honnêtement servir sa patrie pendant de nombreuses années, s'il peut immédiatement épouser une riche héritière et, sans servir, selon le célèbre décret sur la liberté de la noblesse, vivre librement sur son domaine et opprimer les serfs ?
Mitrofan, son père analphabète, battu par sa femme énergique, sa mère criminelle (car elle commet facilement des infractions pénales) et son frère méchant et avare Taras Skotinin forment un groupe pittoresque de personnages négatifs. Ce sont les représentants les plus brillants de la « noblesse sauvage » (Pouchkine), les pères du bar de Griboïedov et les grands-pères des personnages des « Âmes mortes » de Gogol, décrits avec un réalisme étonnant. Tous sont ennemis des Lumières et de la loi, ils ne s'inclinent que devant le pouvoir et la richesse, ils ne craignent que la force matérielle et sont toujours rusés, utilisant tous les moyens pour obtenir leurs bénéfices, guidés uniquement par leur esprit pratique et leur propre intérêt. Ils n’ont tout simplement pas de morale, d’idées, d’idéaux ou de principes moraux, sans parler de la connaissance et du respect des lois.
Prostakova pose une question très importante pour la Russie à l'honnête fonctionnaire Pravdine, qui a pris en charge ses biens : "Tous les décrets sont-ils exécutés ?" Elle et ses proches savent bien que tout le monde ne croit pas que personne n'a besoin de lois dans la vraie vie russe ; elles peuvent toujours être contournées avec succès ou transformées en leur faveur, si seulement il y avait de l'argent et des relations dans les domaines. Par conséquent, ils se retrouvent toujours dans des situations comiques qui révèlent clairement leur tyrannie grossière, leur colère, leur ignorance, leur manque de respect envers les autres et les lois, et leur intérêt personnel. Cette comédie révélatrice est le moteur de la satire de Fonvizine, qui a su montrer la psychologie et la moralité, ou plutôt l'immoralité de toute une classe, les fondements de l'empire, dans la lutte effrontée et brutale des propriétaires sauvages pour la dot d'une riche épouse. .
La figure centrale de ce groupe, le personnage principal de la pièce de Fonvizine, est la véritable immortelle Mme Prostakova. Elle devient immédiatement le principal ressort de l'action scénique, car chez cette noble provinciale il y a une force vitale puissante qui manque non seulement aux personnages positifs, mais aussi à son fils paresseux et égoïste et à son frère cochon. "Ce personnage de la comédie est exceptionnellement bien conçu psychologiquement et superbement soutenu dramatiquement", a déclaré l'historien V.O. Klyuchevsky, expert de l'époque, à propos de Prostakova. Oui, ce personnage est complètement négatif. Mais tout l'intérêt de la comédie de Fonvizin est que sa maîtresse Prostakova est une personne vivante, un type purement russe, et que tous les spectateurs connaissaient personnellement ce type et comprenaient qu'en sortant du théâtre, ils rencontreraient inévitablement la maîtresse Prostakova dans la vraie vie. et serait sans défense.
Du matin au soir, cette femme se bat, fait pression sur tout le monde, opprime, ordonne, espionne, rusée, ment, jure, vole, bat, même le riche et influent Starodum, le fonctionnaire du gouvernement Pravdin et l'officier Milon avec une équipe militaire ne peuvent pas la calmer. vers le bas. Au cœur de ce personnage vivant, fort et complètement populaire se trouvent une tyrannie monstrueuse, une arrogance intrépide, l'avidité pour les avantages matériels de la vie, le désir que tout se passe selon ses goûts et sa volonté. Mais cette créature maléfique et rusée est une mère, elle aime son Mitrofanushka de manière désintéressée et fait tout cela pour le bien de son fils, lui causant un terrible préjudice moral.
"Cet amour insensé pour son enfant est notre fort amour russe, qui chez une personne qui a perdu sa dignité s'est exprimé sous une forme si perverse, dans une combinaison si merveilleuse avec la tyrannie, que plus elle aime son enfant, plus elle déteste tout ce qui ne mange pas son enfant », a écrit Gogol à propos de Prostakova. Pour le bien du bien-être matériel de son fils, elle jette ses poings sur son frère, est prête à affronter Milon, brandissant l'épée, et même dans une situation désespérée, elle veut gagner du temps en utilisant la corruption, les menaces et les appels à des clients influents. pour modifier le verdict officiel du tribunal sur la tutelle de sa succession, annoncé par Pravdin. Prostakova veut qu'elle, sa famille, ses paysans vivent selon sa raison et sa volonté pratiques, et non selon certaines lois et règles des Lumières : « Tout ce que je veux, je le ferai moi-même ».
Il est clair qu'en cela, elle s'oppose obstinément et consciemment à Starodum et à ses partisans partageant les mêmes idées, Pravdin, Sophia et Milon. Elle a répondu à tous leurs sermons éloquents sur la nécessité de combiner éducation et haute moralité avec la célèbre phrase sur les sciences stupides et « non nobles », inutiles et même nuisibles dans la vie réelle. Comme vous le savez, le fils de Prostakov apprend l’immoralité, la capacité de servir uniquement son bénéfice et sa volonté personnels.
Ici, dans la comédie de Fonvizine, apparaît le mot clé pour comprendre toute cette époque, « Liberté », qui est devenu le nom des célèbres odes de Radichtchev et de Pouchkine. Dans le dictionnaire politique russe, il est inextricablement lié au même mot significatif« Loi », qui était aussi généralement écrite avec une majuscule. Et il y avait un nom reliant ces deux mots importants, qui est aussi « Nedorosle », pour tous les nobles et les lettrés de Russie. nom célèbre le célèbre décret du bon et malheureux empereur Pierre III de 1762 - "La loi sur la liberté de la noblesse".
Prostakova, expérimentée dans la corruption et utilisant ses relations personnelles, parle de lui, défendant sa cruauté innée, ses crimes et sa tyrannie : « Ne suis-je pas aussi puissante parmi mon peuple ? Le noble mais naïf Pravdin lui objecte : « Non, madame, personne n’est libre de tyranniser. » Et puis le maître de l’anarchie et de la violence quotidiennes se réfère soudain à la loi : « Je ne suis pas libre ! Un noble n'est pas libre de fouetter ses serviteurs quand il le souhaite ; Mais pourquoi a-t-on donné un décret sur la liberté de la noblesse ? Starodum étonné et avec lui l'auteur s'exclament seulement : « Elle est passée maître dans l'interprétation des décrets !
Par la suite, Klyuchevsky a dit à juste titre : « Tout dépend des derniers mots de Mme Prostakova ; ils contiennent tout le sens du drame et tout le drame est en eux... Elle voulait dire que la loi justifie son anarchie. Prostakova ne veut reconnaître aucun devoir de la noblesse, elle viole calmement la loi de Pierre le Grand sur la scolarité obligatoire des nobles, elle ne connaît que ses droits, qu'elle interprète très librement et toujours en sa faveur et à partir des lois réelles, y compris la loi sur la liberté de la noblesse, qui sont très éloignées. En sa personne, toute la classe militaire refuse de respecter les lois de son pays, ses devoirs et responsabilités, la position de noblesse si appréciée par Fonvizine. Il n’est pas nécessaire de parler d’un quelconque noble honneur, de dignité personnelle, de foi et de loyauté, de respect mutuel, de service aux intérêts de l’État.
Fonvizine a vu à quoi cela conduisait réellement : l'effondrement de l'État, l'immoralité, les mensonges et la corruption, le favoritisme, l'oppression impitoyable des serfs, le vol généralisé et le soulèvement de Pougatchev. C'est pourquoi il écrit à propos de la Russie de Catherine : « L'État dans lequel le plus honorable de tous les États, qui doit défendre la patrie avec le souverain et son corps et représenter la nation, guidé par le seul honneur, la noblesse, n'existe déjà que de nom. et il est vendu à tous les scélérats qui ont volé la patrie.
Ses personnages positifs l'ont dit dans la comédie. On les qualifiait souvent de pâles, sommaires, guindés, porte-parole des idées de l'auteur. C’est en partie vrai. Starodum et ses collègues partageant les mêmes idées parlent et enseignent depuis la scène. Mais telles étaient les lois de la dramaturgie de l’époque : dans une pièce « classique », il y avait toujours des héros retentissants qui livraient des monologues et des enseignements « de l’auteur ». Derrière Starodum, Pravdin, Sophia et Milon se trouve bien sûr Fonvizine lui-même, avec sa riche expérience du service de l'État et des tribunaux et sa lutte infructueuse pour ses nobles idées éducatives dans les plus hautes sphères du pouvoir immoral.
Mais dans les discours de Starodum, un autre point de vue a été exprimé sur le devoir d'un souverain éclairé, le but de la noblesse et sur l'illumination, argumentant avec les « idées » de Mme Prostakova. La satire de Fonvizin n'est pas une fin en soi ; elle ouvre la voie à des valeurs et des idées positives, à ses opinions politiques et pédagogiques. Et ce ne sont pas seulement les vues de l'auteur, mais aussi le programme politique de toute l'opposition noble anti-Catherine, de N.I. Panin à, qui a cité avec sympathie « Le Mineur » et la « Grammaire générale de la Cour » manuscrite de Fonvizine dans « Voyage de Saint-Pétersbourg ». .Pétersbourg à Moscou. Ce n'est pas pour rien que Fonvizine a ensuite eu l'intention de publier la revue "Ami des gens honnêtes, ou Starodum". Mais la police interdit la publication du magazine en 1788. Cela signifie que l'écrivain et le personnage de sa comédie comptaient parmi de nombreux Russes éclairés et opposés partageant les mêmes idées.
Starodum, comme Fonvizin lui-même, a servi à la cour du souverain et a été expulsé pour franchise excessive, honnêteté et loyauté à l'idée de servir un noble à la patrie. Il parle à Pravdin de la cour impériale comme d'un lieu de lutte cynique d'intérêts personnels, où les gens s'efforcent de se détruire, ne se soucient que d'eux-mêmes et de l'heure actuelle, ne pensent pas à leurs ancêtres ou descendants, mais seulement à leur propre matériel. bien-être et carrière personnelle. Les actes altruistes, les mérites personnels, l'éducation, l'intelligence et la noblesse ne sont pas valorisés. Starodum ne dit pas directement que c'est la faute directe du monarque qui permet et encourage tous ces actes et pensées indignes, mais cela était déjà clair pour tous les téléspectateurs.
« Le Mineur » contient une leçon prophétique pour les rois, ressemblant à un avertissement. Le personnage de Fonvizine dresse le portrait d’un monarque éclairé idéal qui ne se laisse pas tromper par les flatteurs de la cour, l’humilier et humilier les autres : « Un grand souverain est un souverain sage. Son travail est de montrer aux gens leur bien direct... Un souverain digne du trône s'efforce d'élever l'âme de ses sujets. Starodum a également parlé d'un noble idéal, honnête et sage, qui se distingue par « l'intrépidité d'un homme d'État qui dit la vérité au souverain, osant le mettre en colère ».
Un souverain éclairé doit gouverner ses sujets éclairés sur la base d’une « loi ferme ». L’existence même de niais et de brutes sur scène et dans la vie russe montre que cela n’existe pas en réalité. Mais l'éducateur et noble russe Fonvizine, avec toute sa comédie, prouve que chacun, et, en premier lieu, le souverain éclairé (c'est-à-dire Catherine II) et la noblesse exerçant honnêtement sa position, doivent s'efforcer d'y parvenir dans tous les domaines de l'imparfait. La vie russe.
Le chemin vers cela est une éducation raisonnable, le désir de bonnes mœurs et de vertu dans l'étude de toutes les sciences : « Croyez-moi, cette science chez une personne dépravée est une arme féroce pour faire le mal. L’illumination élève une âme vertueuse. Seul un paysan éclairé, hautement moral et conscient des siens peut être libre et propre. fonction publique la noblesse. L'exemple de Mitrofanushka montre clairement à quoi peuvent conduire une mauvaise éducation purement formelle dispensée par des enseignants ignorants et une éducation par des parents immoraux : « Nous voyons toutes les conséquences malheureuses d'une mauvaise éducation. Un noble indigne d'être noble ! Je ne connais rien de plus ignoble que lui au monde. Mais le thème de la pièce n’est pas seulement l’éducation et la formation inappropriées du fils du propriétaire foncier Mitrofanushka et l’ignorance de ses parents et de ses « enseignants ».
"Le Mineur" a été écrit au siècle des Lumières, mais c'est dans cette comédie que la satire sur les fausses lumières et l'ignorance se transforme en doutes inquiétants sur l'exactitude de l'idée la plus générale de ce siècle, les enseignements des philosophes des Lumières. avec qui Fonvizin s'est rencontré à Paris et dans d'autres villes d'Europe occidentale. Starodum dit à Sophia, instruite, qui lit des livres français sur l’éducation : « J’ai peur pour vous des sages d’aujourd’hui. Il m'est arrivé de lire chez eux tout ce qui était traduit en russe. Il est vrai qu’ils éradiquent fortement les préjugés et déracinent la vertu.
Ces réflexions ont été développées par l'écrivain dans son célèbre essai « Lettres de France » (1777-1778). Là est clairement indiqué le mouvement des esprits et des idées en Europe occidentale, qui a inévitablement conduit du siècle des Lumières et des disputes scientifiques des encyclopédistes au drame sanglant de la Grande Révolution française : « Je ne saurais vous expliquer suffisamment quelle avarice j'ai trouvé dans la nature de ces personnes dont les écrits ont inspiré, j'ai un respect sincère pour eux... L'arrogance, l'envie et la tromperie constituent leur personnage principal... Chacun vit pour lui-même.
Starodum parle d'éducateurs français connus personnellement de Fonvizine, dont les noms et les œuvres sont inconnus de Mitrofanushka et de Mme Prostakova. Fonvizin dans « Le Mineur » exprime clairement ses doutes sur l'idée la plus importante du siècle des Lumières, estime qu'il s'agit de fausses lumières, de demi-lumières, car dans son égoïsme et son arrogance, il a oublié la moralité, la vertu désintéressée, service, loyauté et honneur. Le siècle des Lumières s’appelait le siècle de la raison et ne respectait pas la foi et la moralité. « Avec des esprits en fuite, nous voyons de mauvais maris, de mauvais pères, de mauvais citoyens. Un bon comportement donne une valeur directe à l'esprit. Sans cela, une personne intelligente est un monstre. C’est infiniment plus élevé que toute la fluidité de l’esprit », dit Starodum à propos du principal défaut moral des Lumières européennes. Il a donné naissance au « Français russe » satisfait de lui-même, Ivanouchka de « Le Brigadier » et à Mitrofanouchka, un digne fils de sa mère illettrée, cruelle et criminelle.
Et enfin, Fonvizin, par la bouche de Starodum, répond non seulement aux propos de Prostakova sur le décret sur la liberté de la noblesse, mais parle aussi directement de la principale raison des dommages causés à la morale et à l'existence même des Prostakov, Skotinins. et Mitrofanushki : « Il est illégal d’opprimer les siens par l’esclavage. » Lorsque Prostakova est informée de la grave maladie de la serf Palashka, elle crie avec rage : « Oh, c'est une bête ! Allongé! Comme si noble ! Un État éclairé ne peut pas être fondé sur une psychologie et une tyrannie aussi inhumaines, sur une telle « compréhension » de l'égalité des peuples et ne peut exister de manière rationnelle et stable, et aucun monarque éclairé ne fera des propriétaires de serfs sauvages et des oppresseurs cruels illettrés des nobles respectueux des lois et des nobles. , leur soutien fiable : « Sur la démocratie et la terre, on ne peut pas marcher là où le peuple, rampant dans les ténèbres de la plus profonde ignorance, porte silencieusement le fardeau d'un esclavage cruel. »
Fonvizine prédit prophétiquement qu'un tel État despotique, dépourvu de lois, de véritables lumières, de citoyens et de défenseurs honnêtes, s'effondrera inévitablement sous les coups combinés de diverses classes mécontentes, aboutira à des troubles et à une rébellion russe impitoyable, et à travers un chaos sanglant et l'anarchie. revenons encore au despotisme le plus cruel. Il s'élève, dans son noble esprit révolutionnaire, vers la pensée du droit du peuple à se rebeller contre ses oppresseurs.
Fonvizin, en tant qu'homme d'État, homme politique doté d'une vaste expérience et écrivain brillant, a mis nombre de ses pensées les plus chères et profondes et de ses prédictions très sérieuses dans la comédie-satire amusante "Minor", mais toutes sont cachées dans les profondeurs de les images artistiques de la pièce. Sa satire suscite le rire, qui est remplacé par l'indignation et une profonde tristesse. Car le public n’a pas vu sur scène le Français bordelais de Griboïedov, mais lui-même, ses proches, des types familiers de Russes. Ils se rendirent soudain compte qu'ils se moquaient d'eux-mêmes.
Les jugements de Fonvizine sur l’État russe, le servage, la noblesse et les Lumières étaient véritablement révolutionnaires, car ils exigeaient avec passion et conviction des changements rapides et décisifs dans tous les domaines de la vie russe. Le peuple russe ne connaissait pas la plupart de ces jugements, mais chaque spectateur et lecteur de « Le Mineur » connaît les conclusions finales du grand écrivain, qui a pris la forme de Prostakova, Mitrofanushka et Skotinin. Et cela fait de la satire véritablement artistique de Fonvizine un document littéraire merveilleux, en aucun cas dépassé, d’une énorme signification sociale et politique, sans lequel tout le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, l’histoire de la Russie, son présent et son avenir sont incompréhensibles.
P.S. Les pièces de théâtre et la prose de Fonvizine contenant de nombreux détails historiques et des propos dépassés qui nécessitent des éclaircissements, nous vous conseillons de les lire uniquement dans une édition commentée destinée aux écoliers. Voir : Fonvizin D.I. Brigadier. Mineure. Grammaire générale de la Cour. Griboïedov A.S. Malheur de l'esprit. M., 2001.
Lexique historique. XVIIIe siècle. M., 1996. Article « Fonvizine ».
Klyuchevsky V.O. Portraits littéraires. M., 1991. Chapitre sur « Le Mineur » de Fonvizine.
Makogonenko G.P. Denis Fonvizin. Parcours créatif. M.-L., 1961.
Pigarev K.V. Créativité de Fonvizin. M., 1954.
Sakharov V.I. La franc-maçonnerie russe en portraits. M., 2004. Chapitre « La voie vers le haut ».
Strichek A. Denis Fonvizine. La Russie des Lumières. M., 1994.
&copier Vsevolod Sakharov. Tous droits réservés.